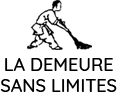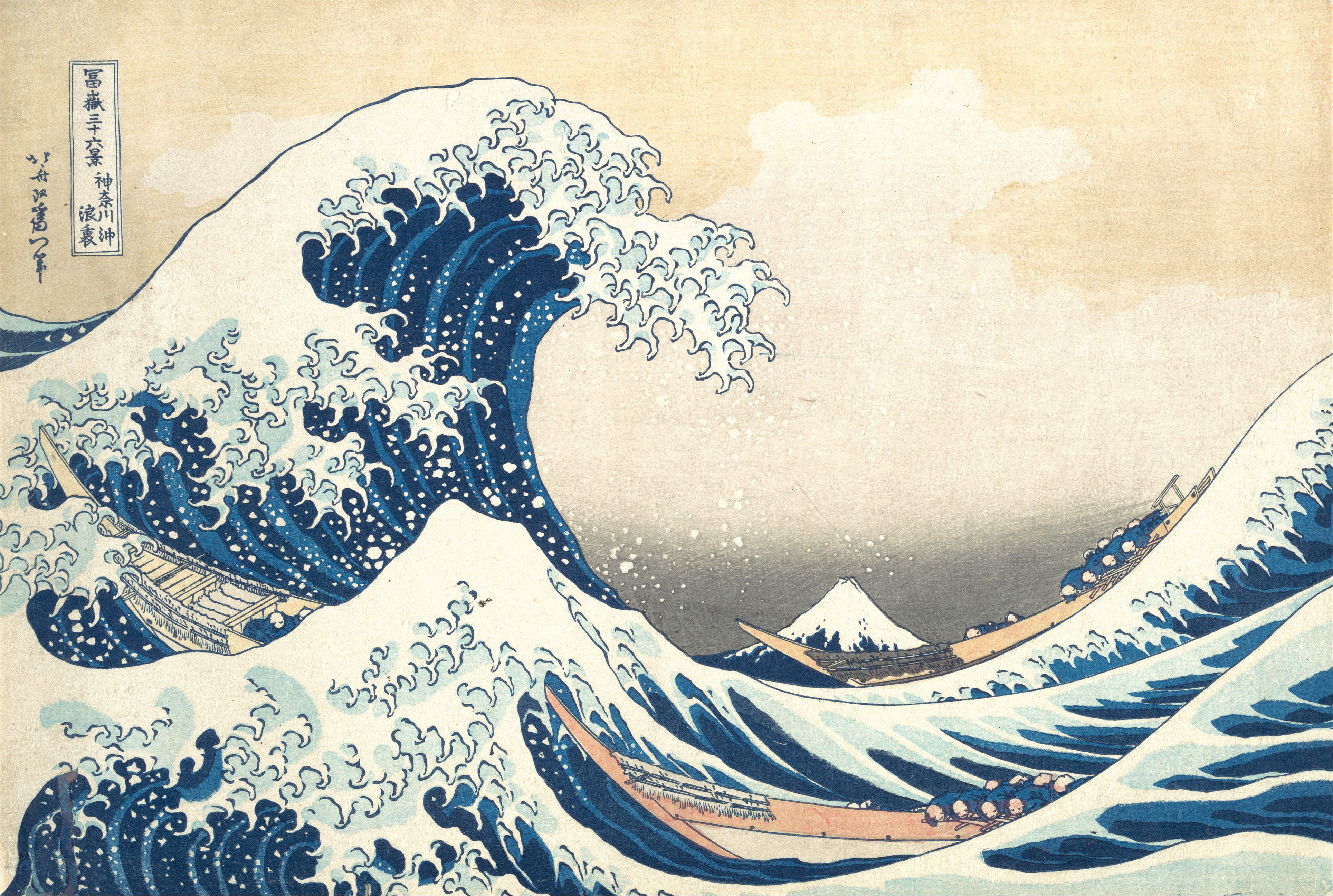par Hiromi Kawakami le 25 mars 2011 (deux semaines après la catastrophe)
Romancière phare de la littérature contemporaine japonaise, Hiromi Kawakami s’est toujours terrée dans l’ombre, loin des éclairages médiatiques. Née en 1958, elle a publié une dizaine de livres hantés par le thème de la disparition, où flottent des personnages irréels, captant les ondes secrètes des êtres, des objets, de la nature. Depuis la catastrophe, elle n’était pas sortie du silence. En exclusivité pour Télérama, elle a écrit d’une traite, au milieu de la nuit, ce texte en forme de vagues…
Voilà déjà plus de trente ans, loin de penser qu’écrire des romans deviendrait mon travail, je multipliais les expériences dans le laboratoire de l’université pour essayer de déterminer la masse des molécules qui règle le mouvement des flagelles des spermatozoïdes des oursins…
Si j’avais choisi de faire des études de biologie, c’était parce que je voulais savoir quelle était la place occupée par l’homme dans l’univers. Qu’est-ce que l’être humain ? Toutes sortes d’approches sont possibles : philosophique, sociologique, psychologique, économique, pathologique, sans oublier la littérature… Pour ma part, j’avais choisi d’étudier l’être humain à travers la biologie.
Je n’étais pas particulièrement studieuse, et il m’a été finalement impossible d’aller au bout de la déclaration qui commençait par : « Biologiquement parlant, l’être humain… » Une chose pourtant, une seule, que mes recherches universitaires m’ont apprise et dont je suis restée profondément imprégnée, c’est que l’homme n’est qu’une espèce parmi les autres. Il croit régner sur le monde et se comporte comme s’il était le maître de l’univers, mais sur une échelle de plusieurs millions d’années, son existence se réduit à une fraction de seconde, bientôt l’extrémité de la branche de l’évolution le rejettera dans le passé, il n’appartiendra même plus à la mémoire et disparaîtra dans une sphère où l’on ignore jusqu’à son existence. Oui, voilà ce que mes études universitaires m’ont appris.
Plus tard, même après que j’ai fini par devenir romancière, cette idée n’a jamais cessé de m’habiter avec force. Encore à présent, cela va sans dire. Pour commencer, la littérature japonaise a de tout temps pensé l’impermanence. Le Dit du Genji, le Manyôshû, les haïkus, les Notes de l’ermitage, Le Dit des Heike, Les Heures oisives. Ces textes de la littérature classique ont pour thème le changement de toute chose, le déclin de ce qui est venu au monde, l’impossibilité de demeurer, bref, le sentiment intense de l’impermanence est au cœur de toutes ces œuvres.
Celui qui reçoit un bienfait
de la nature
doit immanquablement affronter sa cruauté.
Le Japon est un pays doté de la beauté des saisons, que la nature lui fait en quelque sorte payer par certaines cruautés : typhons, sécheresse, séismes, raz de marée. Il n’est pas exagéré de dire qu’il ne doit se trouver personne au Japon qui n’ait été une fois dans sa vie confronté à la brutalité de la nature, car le pays n’a pas cessé d’être victime de catastrophes naturelles de toutes sortes.
Quand le tremblement de terre s’est produit, j’étais dans mon bureau, en train de rédiger le feuilleton que publie le journal Asahi. J’ai senti une secousse. Un tremblement de terre ! Je n’avais jamais fait l’expérience d’une oscillation si forte. Je me suis précipitée, et j’ai vu avec stupeur la maison voisine et les poteaux électriques qui se balançaient.
Qu’ai-je bien pu penser sur le moment ?
« Ça a fini par arriver ! »
Oui, c’était ma première réaction.
Plus tard, j’ai posé la question aux gens de ma famille, aux amis avec qui le contact avait pu être établi.
Curieusement, il ne s’est trouvé personne pour penser que l’impossible s’était produit. Tous m’ont répondu qu’ils avaient éprouvé une sensation de désespoir à l’idée que ça avait fini par arriver. A moins d’habiter dans ce pays, c’est sans doute une chose difficile à croire, mais les Japonais vivent dans la peur d’un violent séisme, qu’ils sont en même temps prêts à affronter.
Tout porte à croire que le sentiment de l’impermanence qui imprègne les Japonais a sa source précisément dans la grâce dont la nature a doté ce pays. Celui qui reçoit un bienfait de la nature doit immanquablement affronter sa cruauté. La nature donne sans compter, de la même façon, elle arrache sans hésitation. L’homme est impuissant à échapper à cette loi. Même les habitants des grandes villes ressentent la contradiction entre l’extraordinaire bonté de la nature et son inclémence.
Oui, chacun est seul quand il
naît,
seul quand il meurt, c’est justement pour cela
qu’il faut s’entraider pour être sauvé.
Les habitants de la région du Tôhoku, ceux qui ont été directement victimes du désastre, assument la situation avec une grande force d’âme, sans colère, en silence. Je sais que cette attitude a forcé l’admiration du monde entier, à commencer par la France.
La douleur de ceux qui ont été directement touchés, la tristesse et la souffrance de ceux qui ont perdu leur famille, leur terre, leur maison… Il m’est impossible de me représenter leur situation, moi qui suis en vie, saine et sauve, à vivre au quotidien. Mais chacun sait ici que le même malheur peut s’abattre à tout moment sur n’importe lequel d’entre nous. J’ai eu la chance d’y échapper jusqu’ici, c’est tout. Mais un jour… Tout est possible.
La nature est impartiale. De façon terrible. Je crois que cette intime conviction peut expliquer le courage avec lequel ont réagi les habitants des régions sinistrées. Tous ceux qui offrent leur aide, qui envoient de l’argent, les nombreuses entreprises qui font don de leurs produits. Les soldats qui travaillent au mépris des émanations radioactives pour remettre en marche la centrale, les pompiers de Tokyo et d’Osaka, les ouvriers sur place. Une foule de gens se sont mis au travail sans un mot. Sans parler des victimes elles-mêmes qui soutiennent silencieusement ceux qui ont souffert plus cruellement qu’elles.
La vie est l’instabilité même. Cette philosophie de l’impermanence sous-tend le comportement de ceux qui s’entraident en silence. Oui, la vie est synonyme d’impermanence, oui, l’homme est éphémère, oui, chacun est seul quand il naît, seul quand il meurt, c’est justement pour cela qu’il faut s’entraider pour être sauvé.
Le sentiment de l’impermanence s’accompagne de renoncement. Les Français auront peut-être une impression négative, assimilant le renoncement à la passivité ou à une sorte d’abandon irresponsable. Je voudrais faire comprendre que cette impermanence liée à une forme de résignation, notion profondément ancrée dans la mentalité japonaise depuis les temps anciens, n’est pas nécessairement haïssable.
La vie est éphémère. Elle ne nous fait pas la grâce de demeurer. Est-ce à dire que moi qui écris ces mots, je ne suis que renoncement, à l’instar des Japonais ?
Absolument pas.
Le sens de l’impermanence ?
Facile à dire !
J’avais plutôt envie de crier : rendez les morts,
rendez les terres englouties !
Je ne suis qu’une chose insignifiante. Triste constatation peut-être. Mais c’est justement ce qui rend ma vie précieuse. Minus habens, certes, mais un rassemblement de cent vingt millions de fétus forme le Japon. Jetés à terre par les typhons, écrasés par les séismes, voilà mille ans, deux mille ans que nous vivons. Tant que la vie est là, on peut connaître des instants lumineux sans nombre. La beauté du crépuscule. La magie des pétales des cerisiers que le vent emporte. La valeur inestimable des proches que l’on éprouve soudain, pour un rien. Le plaisir du soleil couchant en compagnie d’amis. L’évocation des plaisirs de la journée qui s’achève dans le moment qui précède le sommeil.
Dans ma petitesse, je sais bien que ces secondes ne connaîtront jamais l’éternité, et c’est précisément ce qui les fait briller à mes yeux d’un éclat toujours plus vif. Ce scintillement est précieux, sans équivalent. J’éprouve de l’amour pour cet éclat qui s’éteint à peine né. Il me donne de la joie. Il m’attriste aussi. Je crois pouvoir dire que c’est ce bref éclat que je tente d’appréhender et d’introduire dans mes romans.
Bien sûr, je suis consciente que ce que j’ai écrit jusqu’à présent est, d’une certaine manière, théorique. Après le tremblement de terre, à chaque fois que j’avais devant les yeux des images des régions les plus touchées, à la lecture attentive des quotidiens, je ne pouvais pas empêcher mes larmes de couler. Le sens de l’impermanence ? Facile à dire ! J’avais plutôt envie de crier : rendez les morts, rendez les terres englouties ! Cette impermanence que j’avais exprimée à ce jour dans mes romans me semblait soudain désagréablement fade.
Pourtant, tandis que la terre continuait à trembler avec des secousses plus ou moins fortes, à mesure que la terrible réalité se révélait de plus en plus nettement, il me fallait continuer à rédiger le feuilleton que je publie dans le journal Asahi. J’avoue franchement que j’étais incapable d’écrire, car l’histoire que je raconte se situe dans le quotidien. Au moment où ce quotidien volait en éclats, comment était-il possible de continuer à écrire dans l’impassibilité ?
C’est alors que j’ai reçu, six jours après le tremblement de terre, une carte postale de Natori, ville située dans le département de Miyagi. La télévision n’avait cessé de diffuser les images de ravages causés par le tsunami dans cette région particulièrement éprouvée. En voici le contenu : « Je suis sans nouvelles de mon père, qui a été emporté par le tsunami. La tristesse m’empêche de regarder la télévision ou les journaux. A l’heure qu’il est, je suis seulement capable de continuer à lire votre roman qui paraît en feuilleton dans le journal. Car je peux me dire que le quotidien existe toujours quelque part dans le monde. Merci. »
J’ai été parcourue d’une émotion ressemblant à de la ferveur. Ce qui avait secouru l’auteur de la carte, ce n’était sans doute pas la force qui émane de moi en tant qu’individu, non c’était le pouvoir des mots, le pouvoir du récit. Il m’a semblé qu’il m’était de nouveau permis d’écrire.
Mes romans vont-ils subir une transformation ? Oui, bien sûr. La catastrophe à laquelle je m’attendais plus ou moins a fini par arriver. Jusque-là, au renoncement qui était le mien se mêlait l’espoir fragile et complaisant que l’impermanence de la grande nature m’épargnerait peut-être, moi seule y échapperait. Mais décidément, je me trompais. Et c’est justement parce que nul ne peut dépasser l’impermanence que notre petite existence a du prix.
J’ai toujours cherché à écrire la valeur inestimable de la vie. Assurément, ce thème restera le même. Simplement, le dernier tremblement de terre a renforcé mon sentiment de l’impermanence, dont l’intensité a décuplé, centuplé, et mon travail en tant que romancière va en porter la marque ineffaçable.
Fukushima, c’est aussi le
crime de nous tous
qui vivons dans les grandes villes sans nous soucier de rien.
S’agissant du séisme et du tsunami, je crois que les Japonais assumeront ce malheur avec résignation. Il n’en va pas de même pour ce qui est de l’accident de la centrale, toujours dans un état critique à l’heure où j’écris ces lignes, le 25 mars, et il est hors de question pour moi de me résigner à accepter la situation. C’est l’échec des hommes politiques qui n’ont pas fait preuve d’exigence lors de sa construction, c’est notre échec à nous tous qui les avons élus. C’est l’échec des constructeurs qui n’ont pas prêté l’oreille à ceux qui mettaient en doute sa sécurité, c’est aussi le crime de nous tous qui vivons dans les grandes villes sans nous soucier de rien, occupés seulement à l’essor de l’économie, demandant toujours plus à l’électronique, nous qui avons permis pour notre confort l’installation de la centrale de Fukushima loin de la capitale.
Nous qui avons la chance de posséder cette notion de l’impermanence, nous n’avons pas été capables de l’appliquer à nos centrales. Nous avons fermé les yeux, sans vouloir prendre conscience que l’énergie que fabrique l’homme, à qui il est impossible de se soustraire à l’impermanence, ne saurait être figée pour l’éternité.
L’énergie nucléaire, au même titre que la bombe atomique, est une puissance redoutable de contamination, que l’homme laissera sur la Terre après sa disparition, l’être humain dont le passage se réduit à une fraction de seconde. La demi-vie des substances radioactives qui émanent des appareils de la centrale est de huit jours pour l’iode 131, trente ans pour le césium 137, vingt-quatre mille années pour le plutonium 239, quant à l’uranium 235, elle s’élève à sept cents millions d’années. A l’heure qu’il est, je serre les dents en prenant conscience avec âpreté de la signification de ces chiffres. A n’en pas douter, cette amertume imprégnera mes romans à venir, qui connaîtront une transformation sans heurt.