Les enseignements du Bouddha face à la maladie et à la mort
texte de Joshin Bachoux Sensei
PREMIÈRE RENCONTRE
En 1997, j’ai quarante sept ans, je suis nonne bouddhiste depuis une dizaine d’années et j’apprends au cours d’une mammographie de routine qu’on a trouvé une tumeur suspecte au sein gauche.
Quand on se retrouve confronté à ce type de maladie, il semble que brutalement tout ce qui fait notre singularité s’écroule, et nous sommes projetés en face de la vérité crue de notre condition humaine : mortelle.
Quel rapport entre nonne bouddhiste et cancer du sein ?!
J’ai traversé cette période de maladie et de menace de mort comme toute autre personne (sauf sans doute quelques Sages et quelques Maîtres, déjà passés « au-delà ») avec difficulté, avec peurs. Grâce à l’enseignement du Bouddha, grâce aux années de pratique dans les monastères auprès de Maîtres patients et aux années de recherche et de tentatives pour mettre ces enseignements dans ma propre vie, quelques portes se sont entrouvertes.
Ce que je croyais avoir compris, je l’ai redécouvert : ce que je n’avais qu’entendu je l’ai un peu approché.
C’est cette vérité des enseignements du Dharma que j’aimerais retransmettre.
On raconte en Chine l’histoire d’un lettré bien décidé à connaître le fin mot des enseignements du Bouddha. Il visite beaucoup de Maîtres, mais il n’est jamais satisfait des réponses; on lui parle d’un vieux Sage qui vit là-bas, loin au-delà des montagnes. Parce que son aspiration à la connaissance est profonde, il part; il traverse des rivières en crue, franchit des précipices, repousse les attaques des brigands. Quand enfin, après bien des épreuves, il arrive à la grotte du Sage, il lui demande : « Maître, quels sont les enseignements primordiaux donnés par le Bouddha ? » Le Maître répond : « Ne pas faire le mal, faire le bien, aider tous les êtres. » Alors le lettré, dépité après tant de précipices, de rivières et de brigands s’exclame : « Mais Maître, même un enfant de cinq ans sait cela. » « Oui, répond le Maître, mais même un vieillard de cent ans n’arrive pas à le faire! ».
Il y a une idée assez répandue qui suggère que les moines et les nonnes bouddhistes sont des personnes d’une certaine réalisation spirituelle, différentes du commun des… mortels – mais je crois que ce n’est pas vrai. On ne devient pas moine/nonne parce qu’on en sait plus, mais parce qu’on veut en apprendre plus, et même consacrer sa vie à apprendre, à entrer dans l’étude et la pratique des enseignements du Bouddha. Peut-être deviendra-t-on plus sage, peut-être pas. Aucune garantie.
Entrer dans la vie monastique, c’est s’engager sur un chemin de simplicité et de dépouillement. Tout ce qui semblait nécessaire à notre identité, à notre être, nous allons l’abandonner; plus de vêtements personnels : nous sommes tous habillés pareils. Plus de cheveux : les disciples du Bouddha ont toujours le crâne rasé, homme ou femme. L’image de notre corps se transforme. Puis on change de nom, on quitte le nom qui nous reliait à notre enfance, à notre passé pour un nouveau nom dans une nouvelle vie : mort et re-naissance. Chaque journée est rythmée par l’horaire, pas de place pour ses propres habitudes; pas de refuge : plus de chambre personnelle, souvent pas même un lit mais un matelas dans la salle de méditation; plus de préférences : à chaque repas nous mangeons ce que nous recevons dans notre bol. Comme une approche de la mort, apprendre tout ce qu’il nous faudra abandonner – et expérimenter la joie de la légèreté, du non-avoir.
Et puis la méditation matin et soir : un silence où le « je » disparaît – parfois: « Abandonner complètement son corps et son esprit. »
Maître Dôgen1
Alors après des années de cette vie, on peut penser qu’on a un peu appris, un peu fréquenté la mort – je le pensais en tout cas, mais j’avais sous-estimé la différence entre mort symbolique et mort dans le corps. Cancer – au sein même de la cellule : la mort.
Bien sûr on connaît la chaleur du poêle mais le jour où l’on met brusquement la main dessus, on la réalise dans son propre corps. « Je sais bien (que je suis mortel/le) mais quand même… ». J’ai vu que l’identification au corps était toujours bien là. Le choc de l’impermanence ! Comprendre quelque chose avec sa tête, vivre quelque chose dans son corps, quelle différence !
Maître Dôgen dit que la connaissance vraie doit pénétrer « Pas la peau, pas la chair, pas les os, mais jusqu’à la moëlle des os ».
L’impermanence, c’est l’enseignement du Bouddha :
« Notre existence est passagère comme les images d’automne; regarder la naissance et la mort des êtres, c’est regarder les mouvements d’une danse. Une vie entière est un éclair d’orage dans le ciel; elle se précipite comme un torrent qui dévale la montagne. » (Dhammapada). Et lorsqu’il vit certains de ses disciples se désespérer à l’approche de sa mort, il leur rappela : « Comment ce qui est créé ne serait-il pas périssable ? Comment ce qui est né ne serait-il pas impermanent ? »
Mais cette impermanence ne signifie pas : « Alors quelle importance, puisque ma vie va finir de toute façon, pourquoi y faire attention, qu’importe si je détruis mon corps et mon esprit ? » Parce qu’ils ne nous appartiennent pas; parce que nous les avons reçus, comme un don, et que nous devons donc en prendre soin. Même si nous sommes seuls, malades, abandonnés, nous ne savons à quel moment, à qui, cette vie donnée sera un jour utile.
Il est vrai que l’histoire du monde n’est que création et destruction. Un paléontologue a écrit : « Il est clair qu’une planète Terre en mouvement n’offre jamais de conditions stables et durables pour aucune des formes vivantes qui l’habitent. ». Mais ce monde aussi nous l’avons reçu en héritage et nous devons le transmettre. Même si nous savons que tout va disparaître, que dans plusieurs milliards d’années, le soleil lui-même va s’éteindre. Nous vivons maintenant notre vie et chacune de ces vies, non seulement celle de chaque être humain mais de chaque être vivant, jusqu’au plus infime, est précieuse – précieuse et mortelle.
Oui, mais moi ? Moi !? Là, maintenant, peut-être à peine dans quelques mois ? Découverte : je fais partie de l’ensemble; je ne suis pas spectatrice, dans mon fauteuil devant l’écran de télé qui retransmet les souffrances et la mort. Je ne suis pas metteur en scène de ma vie, comme j’en avais l’illusion parfois, essayant d’organiser mon petit, petit monde autour de moi.
Je suis en plein dedans. Il faudra tout laisser. Tout ? Tout. Cela semblait si improbable, si lointain – j’ai l’impression d’avoir jusqu’à présent marché dans le brouillard, et d’un coup, je m’écrase contre un mur, là où j’imaginais une route spacieuse, s’étirant à l’infini.
Maître Dôgen a forgé un nouveau concept : ”Naissance-et-mort”, en un seul mot. Pas naissance à un bout, et mort à l’autre bout là-bas très loin, un jour… non, ”naissance-et-mort”, le tout là, au même instant. Impossible de prendre naissance sans simultanément, sans aucun écart, avoir ”mort”. Nous le savons, des milliards d’êtres humains ont affronté cette réalité avant nous. Chacun a dû, devra refaire la même découverte, le même chemin vers l’acceptation. Comment ne pas être touché par l’histoire de Kisagotami, cette femme portant son enfant mort dans les bras, refusant qu’on le lui prenne pour l’incinérer, se jetant aux pieds du Bouddha, le suppliant de faire un miracle. « Oui, dit le Bouddha, je peux sauver ton enfant; mais pour cela il faudra que tu m’apportes trois graines de moutarde provenant d’une maison dans laquelle il n’y a jamais eu de mort. ». Pleine d’espoir, elle va, frappe à toutes les portes, mais – ici un vieillard, là une jeune femme – dans tous les foyers la même réponse. Et le lendemain matin, triste et silencieuse, elle dépose son enfant sur le bûcher funéraire.
Je suis assise dans un petit square. Je regarde les arbres en fleurs, c’est beau. Je n’ai rien contre l’impermanence des cerisiers en fleurs. Je l’ai fétée au Japon, avec petits gâteaux, thé vert et saké sous les dits cerisiers – ni contre celle de la rose-à-peine-éclose, apprise à l’école – mais la mienne, moi-mon corps, là ça cale un peu.
DEUXIÈME RENCONTRE
Alors je fais un peu de mélo devant le printemps : facile. Fondamentalement notre esprit aime les histoires dont nous sommes le centre, éternel acteur/actrice. Développer des scénarios (et si je… et si cela…), imaginer des dialogues, rejouer des situations déjà vécues ou imaginaires : clichés et lieux communs à fleur de peau, émotions caressées dans le sens du poil (après ce qu’il m’a fait…). Et là je tenais un bon sujet – avec lamentations et incrédulité et rebondissements (métastases ou pas métastases ?).
Ça commence comme ça : « Que c’est beau le printemps ! Et c’est peut-être le dernier printemps que je vais voir ! ». Du présent au futur, du regard à l’appropriation : la fleur me plaît, je la cueille pour pouvoir en profiter plus longtemps. Je fais du mélo parce que, même si c’est vrai, cette idée (dernier printemps ?) est d’abord là pour faire naître de l’émotion. C’est appuyer sur la dent qui fait mal, repasser sur les lieux d’une rupture, ressasser une phrase blessante : construire activement une émotion pour se sentir exister. Presser un bouton et ça marche : même les émotions pénibles, angoisse, tristesse, colère, sont bienvenues dans nos scénarios. Juste s’asseoir et profiter de la vue des arbres en fleurs – l’art de vivre en étant pleinement dans l’instant présent. Ce n’est pas donné, cela s’apprend, c’est l’enseignement de la méditation.
Une partie de cet apprentissage vise à discipliner notre esprit : d’abord voir comment sans cesse on attrape un sujet, un thème : nos pensées vagabondent, ramassent ceci, le lâchent, récupèrent autre chose : dans les textes on compare l’esprit à un singe, c’est amusant à regarder un singe, il voit quelque chose qui brille, il s’en saisit, le goûte, le rejette; fonce sur une ombre, dévie en chemin; il tire à lui et il repousse. Il est mû par toutes ses impulsions, ne reste pas en place… On s’en lasse vite, ça devient fatiguant à voir – et pourtant c’est ce que nous faisons la plupart du temps. Mais nous n’avons que rarement le loisir d’examiner notre esprit pour voir comment il fonctionne. Même la nuit ça ne s’arrête pas, les rêves ou les pensées, toujours en mouvement, que nous ne contrôlons pas.
Discipliner l’esprit – c’est un mot bien rébarbatif que celui de disci-pline ! Cela signifie prendre conscience de l’enchaînement de nos pensées, comment l’une (si belles fleurs : printemps) tire l’autre par association (printemps : prochain printemps) et pouvoir l’interrompre quand on s’aperçoit qu’on va se perdre, ou ressasser, ou faire mal à soi ou à un autre. Puis on peut aller un pas plus avant : qu’y a-t-il à l’origine même de ces pensées. Souvent un simple désir de distraction – plutôt de ”divertissement” au sens pascalien, souvent aussi, nous allons retrouver un des trois poisons entraînant la souffrance décrits par le Bouddha : l’avidité, la colère et l’ignorance.
Là c’est simple, il n’y a pas à chercher loin : j’ai déjà vécu quarante sept printemps – et j’en veux encore ! Pas assez, jamais assez. Encore trente ? Quarante ? Mais non après cela je sais bien que j’en voudrais encore, c’est le piège du désir que d’être insatiable ! Cinq mille, cent mille, deux cent mille ? Ah, deux cent mille, oui, alors là ça se calme. Avec deux cent mille printemps garantis devant moi, je pourrais me tranquilliser; car ce que j’ai eu, je le veux encore, je le veux ”pour toujours”. Ah ! Toujours ! Ne rien perdre, ne rien lâcher, et même avoir encore plus; comme ces esprits du bouddhisme, les gakis. Les gakis sont les habitants d’un des six mondes de la Roue du Samsara, la roue des existences2. Petite tête, petite bouche, cou étroit – et corps énorme… Jamais rassasiés, toujours affamés. Pas seulement de nourriture : il y a les gakis de la réussite sociale et les gakis de l’amour insatiable, les gakis du sexe et ceux du savoir, les gakis matériels et les gakis spirituels – pas difficile de voir un gaki : il suffit souvent de se regarder dans une glace !
Et pourtant l’avidité n’est pas une chose mauvaise en soi. Pas un élément de nous-même que nous devrions éradiquer, par la force ou par la volonté. C’est ce qui nous a permis de vivre : un bébé qui ne serait pas avide de vivre, de respirer, de manger ne survivrait pas. L’avidité c’est aussi la curiosité, le goût d’aller plus loin, de continuer à avancer. L’avidité, ce désir de ne jamais finir, de ne jamais mourir est peut-être inscrit dans nos cellules, dans nos gènes.
On sait que le cancer est une réaction qui privilégie la survie cellulaire : à travers les tissus, une cellule entame un périple dans le temps et l’espace et une fois différenciée (cellule des bronches, de l’intestin, etc.), elle remplit ses fonctions grâce à l’action sur ses gènes d’un grand nombre de substances; lorsque ces fonctions cessent, la cellule normale ”se suicide” en sécrétant une enzyme qui la détruit; un mystérieux signal prévient une cellule souche, qui se divise pour que la perte soit comblée. Mais la cellule devenue cancéreuse fait exactement le contraire, elle ”refuse” de se suicider, elle repart dans l’organisme, elle se fixe où elle ne devrait pas, elle ne ”veut” qu’une chose : survivre. Tout ce qui l’entoure devient menace, elle élabore des stratégies très sophistiquées pour se défendre, aussi bien contre l’organisme (dont elle fait partie) que contre les traitements visant à protéger l’ensemble de ce même organisme. Avidité ! A ne pas vouloir mourir, elle va entraîner la mort du corps et donc la sienne.
On retrouve à notre échelle humaine cette stratégie du refus : refus de se rendre aux circonstances, refus du changement rendu incontournable par une perte, ou un deuil. Nous aussi, nous élaborons des stratégies d’aveuglement ou de défense. Tout ce qui ne va pas dans notre sens devient ennemi, nous nous renfermons, nous essayons de bloquer le cours des choses – autant essayer d’arrêter un torrent avec la main ! Et par ce refus, il y a une part de nous-même qui s’ankylose et qui meurt. Nous cherchons à échapper au changement, et c’est la vie qui nous échappe.
Mais
là non plus, rien n’est complètement blanc, ni complètement
noir
: d’après la théorie personnelle du Professeur Israël, nous
au-rions hérité cette nécessité de la survie de nos ancêtres
bactériens : histoire merveilleuse de ces bactéries qui, à travers
toutes les catastrophes qui ont détruit des milliers d’espèces,
parviennent à survivre depuis trois milliards d’années, à devenir
de plus en plus résistantes à tous les traitements que nous leur
opposons, à communiquer entre espèces différentes pour se repasser
cette résistance… La puissance de la vie envers et contre tout,
qui a permis le jaillissement de la diversité qui nous entoure –
puissance de la vie qui est protégée chez ces bactéries par ”un
arsenal d’armes multi-cibles et de défenses tous azimuts qui se met
en place à la moindre agression et se déploie de façon similaire
contre toutes sortes de menaces potentielles”.
Sans cette résistance, sans ce refus de mourir (difficile d’en parler sans anthropomorphisme) la vie aurait peut-être très tôt disparu de la planète Terre. Nos cellules, en dignes descendantes de ces bactéries, ont intégré leurs gènes; les bons, ceux qui réparent les brins d’ADN comme les autres, ceux qui se hérissent devant l’idée de disparaître : parfois à contre-temps chez l’homme, une cellule va déployer tout son arsenal pour survivre : cancer3.
Ce qui a été source de tout ce qui vit dans l’univers devient pour l’individu menace de mort. Cette faculté géniale qui a assuré l’expansion de la vie se transforme en danger mortel : la frontière entre vie et mort est plus ambigüe qu’il n’y paraissait. Puis-je alors mettre mon existence en balance avec la survie de tout le vivant ?
Oui, je peux !! Je comprends l’ensemble, mais dans la moelle des os… Les moments d’acceptation alternent avec les moments d’émotions.
Choc devant la mort, choc devant ma propre avidité; je reconnais au milieu de ma confusion comment des phrases lues et répétées se sont petit à petit inscrites dans ma tête et dans mon corps, comme ces paroles du Bouddha :
« A ceux qui se trouvent au milieu de la mer
Quand la terreur naît de la masse des eaux,
J’annonce l’île,
A ceux qui sont atteint
Par la vieillesse et la mort,
J’annonce l’île… »
TROISIÈME RENCONTRE
Aujourd’hui rendez-vous chez une spécialiste pour les derniers examens. Elle ne me dit rien, mais ses yeux se détournent quand elle me conseille de prendre très rapidement rendez-vous avec le chirurgien.
Continuer à respirer, sortir, s’arrêter dans la rue devant la porte cochère : des personnes vont et viennent, discutent, font des achats, regardent les vitrines, rient – et moi moi moi, complètement seule, comme déjà séparée, coupée des autres, projetée dans un autre monde.
Moment de souffrance absolue, je reste paralysée sur le trottoir.
Et là une petite étincelle : « Je ne suis pas la seule »; pas la seule femme qui a reçu ce diagnostic aujourd’hui : d’autres en ce moment sont aussi seules dans la rue, ou désespérées devant leurs enfants, ou essayant d’en parler avec leur famille. Je suis seulement l’une d’elles. Et puis d’autres personnes, hommes et femmes, d’autres cancers, d’autres maladies, d’autres souffrances. Je suis seulement l’une d’entre elles. Des malades, des mourants dans les hôpitaux, ce matin, hier, depuis toujours – et moi parmi eux, moi avec eux, il n’y a plus de séparation. Si je tourne le regard vers moi, si ce moi emplit toute ma conscience sans qu’il y ait place pour autre chose, alors c’est intenable, c’est l’enfer. On parle de l’enfer dans le bouddhisme, un autre des six mondes du Samsara, et j’ai toujours imaginé cet enfer comme un espace resserré et étouffant : des murs qui se touchent presque; pas la place de bouger, de respirer – où que l’on se tourne, des murs, pas d’air, pas d’espace. Et nos peurs, nos haines, nos colères enfermées avec nous. Dès que je pense ”moi-moi” je tombe dans cet enfer; mais lorsque je réalise, comme cette femme portant cet enfant mort, que les autres et moi, nous vivons fondamentalement les mêmes choses, les mêmes joies, les mêmes peurs : je suis l’une d’entre eux, ils pourraient être moi. Je vois comment je suis reliée à ces milliers, ces millions de personnes et je suis là – pas au centre mais un maillon ni plus ni moins essentiel, ni plus ni moins transitoire que les autres – un fil de la trame qui unit tous les être.
Alors c’est tout l’espace qui s’ouvre, je peux respirer, nous sommes ensemble – tous reliés au-delà de nos différences superficielles.
Maintenir vivantes ces compréhensions : dès qu’il n’y a plus que des mots comme des feuilles mortes, détachées de l’arbre, toutes recroquevillées et sèches, la souffrance revient, et le refus et la peur.
Souffrance dès que je me renferme sur ce moi, puisqu’il est si transitoire, puisqu’il va peut-être disparaître : je veux m’appuyer et je tombe dans le vide. Mais dès qu’il y a ouverture, regard tourné vers l’extérieur, c’est l’expérience de la tranquillité et de la paix.
Pour m’aider, je prends appui sur le bodhisattva Kanzéon. Bodhisattva : si on regarde du dehors, le bodhisattva semble un intermédiaire entre nous, personnes ordinaires, et Bouddha. Ce qui le distingue du Bouddha, c’est qu’il n’a pas encore réalisé le grand Éveil, il n’est pas entré dans le Nirvana; ce qui le distingue de nous, c’est la résolution sans faille prise en son cœur de se consacrer uniquement au bonheur de toutes les créatures, afin de faire passer tous les autres avant lui sur l’autre rive de l’Éveil.
Chaque bodhisattva représente une facette de la sagesse suprême, et il porte en lui le germe de l’Éveil : l’aspiration à devenir Bouddha, non pour soi-même mais pour aider tous les êtres sensibles. En ce sens le bodhisattva est une part de nous-mêmes puisque chaque être humain peut devenir Bouddha – plus exactement peut réaliser, faire apparaître le Bouddha déjà présent en lui. Le bodhisattva est amour – et cet amour est déjà là, au cœur de chacun d’entre nous. Le bodhisattva est donc à la fois à l’extérieur (ainsi il nous inspire) et à l’intérieur (pas de différence entre Bouddha, le bodhisattva et nous) de nous-mêmes.
Il y a des bodhisattvas inconnus tout autour de nous et les bodhisattvas célèbres du panthéon bouddhique : le bodhisattva de la Sagesse, de la Pratique et bien d’autres, mais le plus connu, et sans doute le plus aimé, est le bodhisattva de la Compassion.
Son nom sanskrit Avalokiteshvara signifie « Le Seigneur qui regarde d’en haut (avec miséricorde) ». En Chine, il est souvent représenté sous sa forme féminine, et s’appelle Guanyin. Au Japon, c’est Kanzéon (ou Kannon) : « Celui qui écoute les cris du monde » ou « Celui qui répond aux souffrances du monde ».
Il existe beaucoup de représentations différentes de cet être de compassion puisque Kanzéon à la faculté de se présenter sous l’aspect qui convient le mieux à chacun; c’est parfois une silhouette méditative vêtue de blanc au cœur de la montagne, parfois Kanzéon à tête de cheval, qui se consacre plus spécialement aux êtres nés dans le monde animal. Et puis, celle que je garde devant les yeux, Kanzéon ”qui fait face à toutes les directions”, Kanzéon aux onze visages, et aux mille bras. Dans chaque paume de main, un œil : voir la détresse, agir pour la secourir. Kanzéon, ce n’est pas une statue, mais une part de chacun : s’arrêter pour secourir quelqu’un, sourire, aller vers un enfant qui pleure – C’est Kanzéon.
Sans réfléchir, sans calculer, simplement lorsque je ressens la souffrance de l’autre et que j’y réponds. C’est un geste d’unité : soulager l’autre c’est me sentir bien. Nous le faisons sans le savoir et celui qui reçoit notre aide n’en est pas embarrassé. La moindre ombre de ”moi” rend souvent notre aide difficile à accepter pour l’autre et nous ne comprenons pas pourquoi : « Moi qui… voulais l’aider… ». Mais c’est qu’à ce moment-là, il n’y a plus Kanzéon face à Kanzéon, je suis bien « Le Seigneur qui regarde d’en haut », mais la miséricorde, la compassion – au sens d’être un avec – a disparu. Kanzéon c’est les autres et moi, ensemble.
Et cette histoire qui me revient sans cesse à l’esprit, une de ses histoires zen dont le sens semble si difficile à saisir, jusqu’à ce qu’elle pénètre ”jusqu’à la moelle des os” : le moine Lungan demande à Maître Dôgô : « Comment est-ce que le bodhisattva Kanzéon utilise toutes ses mains et tous ses yeux ? ». Dôgô répond : « Comme une personne en dormant arrange son oreiller au milieu de la nuit ».
Là où il n’y a plus ”moi” et ”toi” – une transparence totale – personne pour donner, personne pour recevoir – le don pur.
Je sais que je peux choisir : ignorer tous les êtres et rester seule, ou reconnaître que moi aussi, comme chacun, j’ai dix mille yeux et dix mille bras, et me tourner vers les autres : il n’y a qu’une réalité, dont nous sommes tous une partie. Parce que la fin de la souffrance de tous les êtres commence aussi par moi : comprendre ma propre souffrance c’est partager celle de tous les autres, alléger ma propre souffrance c’est alléger la souffrance du monde. Moi – ”sac de peau”4 est souffrance, moi-Kanzéon est paix. Il n’y a pas de choix, mais effort, oui, pour ne pas se laisser aller à l’inertie du moi, à la soi-disant évidence ”moi ce n’est pas les autres”, au repli, à la coupure : l’enfer.
Se rappeler – oublier. L’esprit qui essaie de s’accrocher, l’esprit qui lâche prise. Je n’ai rien fait de spécial, je me sens une personne bien ordinaire – confrontée à quelque chose de très grand, de très difficile. Une question essentielle, pas un jeu de l’esprit mais une chose très concrète, qui suis-je ? Je dois donner une solution tout de suite, une réponse urgente; pas pour me faire plaisir, ou réaliser un grand éveil, une grande illumination mais parce que c’est exactement au sens premier du terme une question de vie et de mort : qui suis-je ? Et ”moi”, ”moi” je n’ai pas de réponse – mais seulement du refus, l’envie de ne pas être là, pas à ce moment-là, pas exactement où je suis.
« Je sais bien… » qu’il n’y a pas d’autre endroit, pas d’autre possible que ce qui y est – mais le savoir de la tête, le savoir des mots n’est d’aucune aide. Je l’ai lu et relu : « Tout n’est qu’illusion, le moi la plus grande des illusions », mais illusion pour illusion, j’en choisirais bien une autre… des siècles plus tôt, déjà, cri du cœur du poète : « Rosée que cette vie, rosée, et pourtant… ».
Mais le Dharma, l’enseignement du Bouddha me montre la seule solution, la seule réponse : oui – une acceptation totale, mais une acceptation de tous les instants, de toutes les circonstances, de tout le vécu : oui à la maladie, oui à la peur de la maladie, oui à la mort et oui à la peur de la mort. Oui, sans jugement, sans « Je devrais », « Je ne devrais pas »; oui à ce que je suis, ce que je vis, ce qui est aujourd’hui, ce qui sera demain.
Oui, ce n’est pas un oui du bout des lèvres, parce qu’on est écrasé, par résignation; c’est un élan de tout notre être, corps et esprit confondus. Bien sûr, cela ne veut pas dire ne pas prendre soin de soi, ne pas se soigner quand c’est nécessaire – bien au-delà, c’est un oui à ce qui est.
Faire un pas en avant, s’ouvrir, ne pas bloquer, ne pas refermer, ne pas refuser de bouger alors même que toutes les choses changent autour et au dedans de moi : le oui qui englobe tout, voilà l’enseignement que j’ai reçu et l’occasion, la nécessité de le mettre en pratique.
Enseignement qui me touche au plus près puisque c’est la signification de mon nom de nonne : ”JÔ-SHIN” : JÔ pure, SHIN foi : Foi Pure. Pendant des années ma question a porté sur le premier mot : Foi. Foi ? En qui ? En quoi ? Quelle foi dans le bouddhisme ? Le Bouddha a souvent répété : « Ne croyez pas une chose parce que je la dis, ne croyez pas une chose parce qu’elle est écrite mais regardez si ces enseignements sont bons, qu’ils ne font pas de mal, que les personnes sages les acceptent car leur pratique entraîne bonheur et compassion. ».
Nous sommes encouragés à expérimenter les enseignements, vérifier que cela est le bon chemin qui nous mène vers moins de souffrance et plus de joie. Et puis quand nous voyons que cela est juste, nous pouvons avoir confiance – peut-être une première étape vers ”foi”. On entend dire : « J’ai confiance dans la vie » – ou seulement « Je ne crains rien, j’ai confiance. » – Là il faut gratter un peu, qu’est-ce que cette confiance recouvre ? Souvent sans en avoir conscience, nous pensons « J’ai confiance parce qu’au fond je sais
bien que tout va s’arranger comme je veux. » – Une forme de pensée magique : puisque j’ai confiance, je mérite bien d’en être récompensée. Et on a construit une protection imaginaire, un donnant-donnant subtil : comme une petite digue en bambou et si une grande vague arrive et nous balaye nous nous écrions « Ce n’est pas juste ! Moi qui avais confiance ! Alors là j’ai compris, la confiance ça ne marche pas; maintenant je ne croirai plus en rien, ni en personne. »
Exact, la confiance dans ce sens-là ne marche pas. La confiance ne se marchande pas : il y a seulement j’ai confiance. Point. J’ai confiance : je peux m’ouvrir assez pour accepter tout ce qui va arriver. La ”confiance-point” ne nous décevra jamais puisque nous ne construisons rien. Il n’y a pas d’abri, pas de murs, rien à perdre. Il ne s’agit pas d’échafauder une théorie pour se consoler : aucune théorie ne tient devant les grandes vagues de la perte, du deuil, de la mort. Il s’agit de faire entrer, jusqu’à la moelle des os « Que ta volonté soit faite ». Foi s’écrit en japonais en réunissant deux signes : le signe de la personne et le signe de la parole. La parole d’une personne, la parole du Bouddha – non pas y croire parce que ”c’est comme ça”, mais la laisser imprégner le corps et l’esprit, découvrir dans le mouvement même de la vie, la vérité contenue dans cette parole. Il ne restera alors que confiance. Point. Foi. Point.
Et puis ”Pur” était resté un peu de côté, pendant les tâtonnements qui me menaient vers ”Foi”. Il a réapparu, au fil d’une lecture « Corps et cœur-esprit complètement purs ». C’était une parole libératrice car je me suis rendue compte que j’entendais pur en opposition à impur, et que je devais trouver ce qu’était ”pur”, seul, sans opposition. Si le corps et le cœur-esprit sont purs, il ne reste plus de place pour impur. C’est une qualité intrinsèque qui ne peut être changée, ni ôtée, ni modifiée : si je comprends cette parole au-delà de la dualité, je peux voir les autres et moi et toutes les choses dans la transparence de cette pureté. Lorsque la foi pure est là, elle imprègne toutes choses, elle englobe tout sans distinction, comme le soleil qui brille sur toutes choses sans choisir : un rayon de lumière passe par la fenêtre et même la poussière se change en or. Maître Dôgen : « Quand la foi pure apparaît, elle change les autres comme elle nous change nous-même. ».
Cette foi pure, c’est dire oui, bienvenue. Bienvenue à tout, pas seulement à ce que je désire, à ce que j’attends. Être assez spacieux pour accueillir tout ce qui se présente. Oui. Quel travail !
Le travail de la méditation d’abord. Difficile à comprendre comment le fait de rester assis, sur un coussin, ou bien sur une chaise, sans bouger peut nous aider à résoudre les problèmes posés par notre vie quotidienne.
La méditation dans le zen, ”zazen” ne se fixe sur aucun objet, sur aucune phrase; ce n’est pas une technique, cela ne consiste pas à vider notre esprit, à respirer de façon spéciale, ni à s’identifier à un son, une lumière ou autre chose; c’est ”être là” – pleinement, consciemment, attentivement. Être là instant après instant, respiration après respiration. « Mais ça tout le monde le fait ? ». Asseyez-vous cinq minutes et regardez où vous arrivez : hier, demain, là-bas, au bureau, en vacances.. Si peu ”ici et maintenant”. Constructions mentales : peurs ou espoirs dans l’avenir, joies ou blessures du passé, vivement demain, vivement la semaine prochaine… Des pensées qui tournent, répétitives – des émotions, encore. D’abord apprendre à être là, à dompter cet esprit rétif comme un cheval sauvage. La méditation n’est pas une fuite. La fuite, tant d’occasions dans notre vie ! Livres, TV, films, discussions, rêveries… Ce n’est pas un abri, un refuge, comme un jardin secret où nul ne pourrait entrer. Ce n’est pas prendre de la distance, bâtir des murs pour ne plus être embêté par ce monde extérieur qui refuse si obstinément de se plier à mes désirs. Au contraire, c’est ouverture, espace, transparence; dans le calme d’abord, puis dans le silence. Comme un verre d’eau puisé dans la rivière : d’abord flottent toutes sortes de particules, l’eau est trouble, mais si on le pose, si on ne le bouge plus, petit à petit les impuretés se déposent au fond et l’eau devient transparente. La méditation, le zazen, dans mon école s’appelle réflexion sereine, au sens où un grand miroir vide réfléchit la lumière, ou illumination silencieuse.
La méditation est la racine du oui.
Petit à petit elle imprègne la vie : ce n’est pas réservé à un lieu, un moment, un contexte spécial. Ce n’est pas opposé au monde de l’activité, du travail, des rencontres. C’est une qualité propre dans notre vie : être là, dans toutes les situations, être en harmonie. Étant nous-mêmes en unité, nous entrons en unité avec tout ce qui nous entoure. Parce que cela est difficile au sein de la vie quotidienne, nous prenons le temps de la méditation assise, plusieurs heures par jour pendant les retraites dans les monastères – et depuis des années cette méditation m’accompagne comme le corps est accompagné de son ombre : parfois très présente, parfois indiscernable. Mais au milieu de cette confusion, je continue plus que jamais à prendre le temps de m’asseoir, de revenir à moi-même, de retourner au vrai silence.
Comment dire que la méditation sera là tout au long de cette maladie, tout au long de ces pages, à chaque pas, non pas pour m’y cacher, pour essayer de me soustraire à ce présent douloureux, mais au contraire pour le vivre, totalement, ici et maintenant.
Un Maître zen contemporain Maître Uchiyama l’a bien résumé : « Même si le diable me fait sauter dans sa poêle, je continue à faire zazen. ». Moi aussi, je saute et je brûle avec les autres; je poursuis zazen avec les autres.
La méditation, zazen, c’est s’ouvrir à chaque respiration comme on ouvre une porte pour accueillir ses hôtes : ouvrir la porte, sourire, et accueillir tout ce qui se tient sur le seuil : bienvenue.
Ici, pendant ces jours de bouleversement, j’entre dans la compréhension de cette ”foi pure” qui m’accompagne depuis dix ans. Le oui se fait un peu de place : la seule réponse, toutes les autres ne débouchent que sur la souffrance. Oui, parce que cela est – le reste n’est que fantasme, fantaisies, tentatives vouées à l’échec de construire ”mon” monde, mon paradis et moi toute puissante.
Quand je fais ce pas vers, ou dans, ce oui, tout se détend, mon esprit comme mon corps – les craintes s’évanouissent, tout est harmonie.
Puis, comme des portes qui se referment, je ne suis plus sûre : ai-je vraiment vécu cela ou l’ai-je rêvé ? Où est passé tout cet espace, où a disparu toute cette beauté ? Retravailler, avec patience, accepter ses limites, jusqu’à revenir au oui qui englobera également ces moments de ”nuit obscure”. Retour à la méditation.
QUATRIÈME RENCONTRE
Nous chantons tous les matins : « La Voie du Bouddha est sans fin, je fais vœu de la suivre ».
Sans fin : il n’y a pas d’acquis à mettre de côté; la Voie du Bouddha, la vie, n’est pas un objet fini, bien clos. Il n’y a que le chemin, que je trace moi-même à chaque pas, à chaque respiration, à chaque instant. Je ne vais arriver nulle part, pas de port, pas de havre : dans la Roue des existences le paradis lui-même est transitoire. J’ai envie de croire qu’un moment difficile va se terminer, et qu’ensuite tout ira bien…
Mais le chemin est neuf à chaque instant, il faut continuer, et quoi qu’on trouve en avançant, continuer encore. Je ne peux m’installer nulle part. L’expérience acquise, la compréhension ne sont que des bases partielles à partir desquelles je devrai apprendre encore. Comme lorsqu’on avance sur un sentier de montagne, le paysage se fait plus vaste; l’œil ne peut le saisir en entier, la main ne peut pas l’attraper. Dès que je pense « Ça y est, j’ai compris » ou « J’ai accepté », on retombe dans le petit moi, on se raconte des histoires, on croit qu’on possède quelque chose – mais tout s’échappe; on se retourne : l’enfer, case départ.
Le jour de l’opération est fixé. Je dois arriver de bonne heure à l’hôpital, un peu loin en banlieue. Sans trop penser, gardant un œil sur la discipline de l’esprit, je prends le RER, puis un bus. Au fil du trajet, sans m’en apercevoir, la discipline s’efface devant un nouveau mélo, quelque chose comme « Tous ces gens autour, fatigués, de mauvaise humeur, et moi alors, moi moi moi qui vais me faire opérer d’un cancer, moi qui… moi que… ». J’arrive devant l’hôpital, un immense bâtiment de béton, quelques lumières, quelques silhouettes. Émotion : « Alors là, c’est vraiment un instant important dans ma vie… devant l’hôpital où on va… etc. Et en plus je suis toute seule, pas de compagnon, d’enfants ou d’amis auprès de moi, etc. Toute seule. ». Je suis l’héroïne du scénario, le centre du monde. Moi.
J’avais souvent répété pour moi-même ou pour d’autres, cette phrase de Maître Dôgen : « Est-ce que je regarde la montagne, ou est-ce la montagne qui me regarde ? ». Je la trouvais stimulante, poétique, drôle. Mais quand elle déboule à l’improviste dans ce flot de pensées j’ai l’impression de sauter de l’autre côté du décor et d’apercevoir la machinerie qui sous-tend la pièce.
Comme d’un geste preste on remet un vêtement à l’endroit, mettant en lumière la beauté et la richesse de l’étoffe qui semblait si terne, je peux voir soudain la vraie texture de cet instant : quelle merveille!
La fatigue, la tristesse s’effacent, et, né de l’immense gratitude qui m’emplit, apparaît le deuxième mot, l’autre face du oui : merci.
Je ne sais pas en fait à qui s’adresse ce merci : c’est un changement de perspective total, un bouleversement profond : je venais enfermée en moi-même et tout-à-coup ce merci jaillit et brise tous les murs. Ce merci est bien plus grand que moi et il englobe et dépasse l’hôpital, et toutes les personnes qui y travaillent, toutes celles qui sont en route pour y venir. Il dépasse la raison de ma présence – Il est cette ”présence” même car il s’adresse aussi à toutes les personnes croisées dans ma vie – et à toutes celles qui me sont inconnues. C’est un merci qui résume toute ma vie, qui la transforme en un don sans limites et me donne envie de me partager avec tous les êtres. C’est un merci qui dépasse ma vie, car il me traverse, il était là avant moi, il est la nature même de chaque personne et de chaque chose. Je ne fais que le mettre à jour, l’actualiser avec mon corps et mon esprit. Il est communion, unité. Il me semble à cet instant que c’est la seule approche possible de ”la-vie-la-mort”, notre composante la plus solide et la plus intime. C’est l’écho de la naissance du moindre brin d’herbe et de l’apparition de Kanzéon, porté par l’air, il se réverbère à l’infini, pas un atome de poussière n’en est exclu. Merci.
Ce matin je réalise pour la première fois ce que le Bouddha appelle ”ignorance” : la fausse croyance en un moi séparé, et son antidote : oui, merci. Et la gratitude, celle qui ne dépend pas des évènements et qui s’adresse à tous sans exception, sans réticence fait naître en moi une joie profonde. Joie sans objet qui recouvre tout; je ne suis plus qu’un réceptacle vide (et peut-être est-ce encore trop) traversé par cette joie. C’est le début et la fin, l’espace sans limites, la danse sans danseur. Oui. Merci.
De ce moment tout devient plus simple, plus léger – même si je ne le vis toujours que de façon transitoire. Sans savoir comment, je me retrouve dans la colère « Pourquoi est-ce qu’elle ne frappa pas à la porte de la chambre avant d’entrer ? » ou dans la crainte « Quand même ces médecins qui ne me disent rien… ».
Parfois séparation et souffrance, des pensées qui bourdonnent, des émotions qui jaillissent. Si je reste attentive, je peux sentir la crispation qui les accompagne dans les épaules, le ventre, les jambes. Respiration, retour au calme : le corps se relâche, le visage se détend. Impermanence de la compréhension même.
Et depuis, je continue. Je continue à passer de l’ombre à la lumière – et dans la lumière je m’aperçois que l’ombre n’existe pas. Je continue à oublier et à m’agiter ”moi, moi, moi” et à revenir, encore et encore, à merci. La joie pourtant, comme le grand ciel bleu, parfois visible, parfois non, mais toujours là.
Respiration : « J’ai jeté cette petite chose qu’on appelle le moi et depuis je suis empli par l’univers entier »; chant de joie du moine Mûso, et je danse avec lui. De temps en temps, je le perds un peu de vue ce moi, triste ou joyeux, craintif ou brave. Puis je me surprends empêtrée dans la reconstitution laborieuse de mon petit monde, qui s’écroule aussi vite que je le construis.
Comme le dit si drôlement Pema Chödron : « Alors c’est donc ça le chemin qui a du cœur, on dirait plutôt le chemin du vol plané dans la boue. ». Et on apprend à tomber – et à se relever. On apprend surtout à accepter de tomber, le nez par terre ! Finies notre belle dignité, nos certitudes. Bienvenue au vol plané dans la boue ! Petit inconfort ou grand enfer, ça va. Bienvenue à tout ce qui se présente, c’est aussi je crois la grande patience face à notre lenteur, à nos entêtements. Merci, je dois le dire aussi à moi-même.
L’humilité de la chute, c’est aussi m’apercevoir combien je tenais à un certain nombre de motifs – peut-être pas de fierté – mais disons de satisfaction. Un objet agréable, le motif de satisfaction : « moi-je ». On peut le tourner entre ses mains pour l’admirer sous toutes ses faces, le poser, le reprendre, jouer avec. « Moi, j’ai toujours… moi je n’ai jamais… ».
Je ne veux pas dire, loin de là, que nous devrions demeurer éternellement insatisfaits de nous-même : la tolérance envers moi-même va fonder ma tolérance envers les autres; si je me critique sans cesse, il y a de fortes chances pour que je critique sans cesse les autres aussi. Le premier travail du oui sera l’acceptation totale de ce que je suis – bons et moins bons côtés, parce que c’est là mon point de départ ! Je n’en ai pas d’autres que moi-même ! Je dois accepter de ne pas être parfaite – et j’accepterai mieux l’imperfection des autres.
Si je n’ai pas d’amour pour moi comment pourrais-je même me représenter l’amour pour les autres ? Si je ne reconnais pas : « moi-Kanzéon » – qui inclut ce petit moi imparfait – comment le reconnaîtrais-je chez les autres ? Cette insatisfaction fera obstacle et m’empêchera de vivre les 10 000 bras et 10 000 yeux qui m’unissent aux autres. La gratitude vraie ne différencie pas entre nous et les autres.
Mais c’est une bonne idée de repérer tous ces petits ”moi-je » qui nous permettent de nous tenir à l’écart de la foule des autres – voire un peu au-dessus. J’en ai trouvé un certain nombre : « Moi, je n’ai jamais manqué une méditation du matin depuis que je vis dans les temples… » « Moi qui suis capable de travailler plus que n’importe qui » – Écroulement d’un grand pan de l’ego ! Non seulement je ne me suis plus levée le matin, non seulement je n’ai plus travaillé, mais j’ai appris à rester tranquille, à remercier avec reconnaissance les personnes qui préparaient ma nourriture, lavaient mes affaires, faisaient le ménage pour moi. Gratitude. Jamais facile. J’ai tout plein de Bonnes Raisons pour être maussade, irritable : mal-ci, mal-là, pas dormir, pas manger… « Ce n’est pas ça que je voulais, pas maintenant; justement, je me reposais… » Je suis vaguement jalouse de ces personnes capables d’aller et venir sans effort, de marcher et de courir. « Moi qui étais si active, qui faisais tant de sport, et d’arts martiaux… ». Ça paraît si tentant de laisser ce ”je” envahir la journée, de s’apitoyer un peu sur soi-même, de s’accrocher à l’image qu’on se fait du passé : je le vois bien, je le fais parfois; on a envie de se rouler en boule sur sa souffrance, et la souffrance devient tout notre univers, emplit tout l’espace – temps figé, corps crispé : enfer. « Ce que j’ai eu, pourquoi est-ce que je ne l’ai plus ? Ce que j’aimais, pourquoi est-ce que je dois l’abandonner ? ». Fausses questions, il n’y a pas de raisons mais le travail de l’impermanence : mon corps change, mon esprit change; les conditions, intérieures ou extérieures, changent : encore et toujours l’impermanence. Et la même réaction d’avidité : je veux tout – pour toujours.
Respirer, revenir à la transparence, se tourner vers Kanzéon : Kanzéon en moi quand je fais l’effort de lâcher la tentation de l’enfermement ; Kanzéon chez les autres quand je tourne mon regard vers eux. Alors, j’ai, nous avons tous 10 000 bras, 10 000 yeux… qu’y a-t-il que je ne puisse faire ?!
Tout se remet à l’endroit : merci pour tout ce qui est donné, merci pour tout ce qui reste – et un jour ou l’autre, je devrai apprendre à réduire ce ”tout” à ”presque rien”, et dire encore merci. Et merci enfin pour tout ce que j’ai eu dans cet ”avant” : ce merci va m’aider à clore le passé et me permettre de le laisser reposer.
Deux ans après, je vais bien, c’est en tout cas ce que disent les derniers examens. Je ne sais pas comment je réagirai, si dans six mois ou dans vingt ans, je rechute. Et surtout j’essaie de ne pas me faire attraper par des illusions, des constructions mentales flattant mon ego « La prochaine fois je serai plus ci… moins ça… ». Car cette réaction fabriquée à l’avance recouvrant ce que je ressens réellementm’obligerait à mentir, à moi-même et aux autres. Je serais bloquée dans une image de moi, coupée de mes émotions, toute mon énergie consacrée à tenir ma propre statue à bout de bras ! Quelle souffrance, bien pire que n’importe quelle peur.
Alors que le oui, le merci continue à s’agrandir pour pouvoir tout englober, de la joie à la tristesse, de la vie à la mort.
Et le Dharma, l’enseignement du Bouddha m’apprend une chose essentielle: que je sois malade, que je meure, ce sont là les conséquences naturelles de ma naissance. Ce n’est pas un échec, pas un échec de la méditation, pas un échec de la médecine, ni de moi-même.
C’est refuser la réalité de notre nature humaine que de croire qu’on peut se mettre du côté du ”bon” (bonnes pensées, bon esprit, bonne nourriture, ”bon karma”) et que cela nous préservera du ”mauvais” – alors on ne mourra jamais ?
Il n’y a pas des gagnants en bonne santé et des perdants malades. On peut voir la mort, comme un passage, une transformation ou une fin – mais la mort n’est en aucun cas une défaite : tout le monde va mourir, et vous et moi aussi – ”vie-et-mort” en un seul mot : « Tout ce qui est composé est impermanent; tournez vos efforts vers la libération. », ce furent les dernières paroles du Bouddha.
En tant que pratiquants du Dharma, nous considérons que ce qui nous arrive, tout ce que nous rencontrons dans notre vie découle du karma, c’est-à-dire de l’enchaînement des causes et des effets. Un acte entraîne une conséquence, qui à son tour devient une cause, ainsi de suite. Ce qui survient dans cette vie peut être le résultat des actes de la vie précédente – ou de cette vie même – et les actes de cette vie porteront leurs fruits dans une vie future. Mais attention, il n’y a rien là de linéaire, lois du karma et lois naturelles s’entrecroisent : on ne peut jamais pointer du doigt un événement de notre vie, ou celle de quelqu’un d’autre, ou un problème, un accident, etc. et dire : « C’est parce que je/vous avez commis des fautes dans le passé ! ». Le Bouddha met en garde souvent contre cela, disant que nul ne peut démêler son propre karma – sûrement alors encore moins celui des autres. Mais lorsque nous nous voyons à travers les yeux de Kanzéon, le jugement disparaît – ne reste que l’égalité totale moi et les autres.
Le karma n’est pas rigide, ce n’est pas un destin (ni une excuse à nos insuffisances !) : à chaque instant nous pouvons changer; et il me semble aujourd’hui que la seule porte vers ce changement c’est ce oui, ce merci total. Ils font s’écrouler les murs de la souffrance mais n’empêcheront jamais la maladie et la mort inhérentes à notre forme d’être humain.
SAMADHI (une sorte de…)
C’est un autre square, un vrai square de carte postale : minuscule, entre deux immeubles avec des gamins qui jouent, des jeunes qui s’embrassent et des personnes âgées assises le sac sur les genoux. Avant je ne l’avais jamais remarqué, je marchais à toute allure, avec un but, ou pour le plaisir. Pourtant il n’est qu’à un pâté de maisons de l’appartement.
Je suis sur un banc à regarder autour, pas de journal, pas de livre. Un groupe de lycéens traverse le square en chahutant, je sens mon corps qui se recroqueville; dehors est devenu un peu dangereux : peur des rollers, des skates, des distraits ou des pressés; peur d’être heurtée, de tomber. J’ai un bras toujours replié sur le côté gauche, et la main droite prête à chercher un appui. Comme dans un conte de fées où on s’endort jeune, et on se réveille centenaire, je fais l’expérience d’un autre corps, d’une autre ville.
Je suis de plain-pied avec le quatrième âge, et je m’étonne parfois qu’on ne m’aide pas à traverser la rue. Dix minutes passent, et je commence à me sentir mal fichue, une vague envie de m’allonger sur le banc, il est temps de rentrer. La grille du square est lourde à tirer, d’ailleurs la porte de l’immeuble aussi est devenue très pénible à ouvrir. Je marche comme nous le faisons dans la salle de méditation, lentement, à petits pas, au rythme de la respiration. Je suis consciente de chaque pas, de la texture des pavés sous mes pieds, de l’air que je respire. J’ai le temps de regarder chaque vitrine, chaque entrée d’immeuble. Je sens le plaisir de bouger mon corps, les articulations un peu raides, et aussi quelques signaux d’alarme qui disent qu’il est temps de rentrer.
En
bas de l’escalier, je retrouve ma voisine de palier, madame B.
94
ans. Son aventure à elle, c’est descendre son petit sac plastique
jusqu’aux poubelles. Quand j’arrive, elle est en train de prendre son
élan pour les quatre étages à remonter.
Nous nous faisons des politesses : « Allez-y » « Mais non, je vais très lentement, vous d’abord », etc. – et nous y allons. Elle me double dans la montée du troisième étage. Enfin j’arrive, m’allonger, me reposer un peu.
Je sens la détente de mon corps, les plis des couvertures sous mon dos, l’air léger au-dessus de mon ventre. Je suis présente du bout des doigts de pied jusqu’au crâne. Parfaitement satisfaite corps et esprit. Dans une autre vie, je pouvais traverser Paris du nord au sud à pied ou en patins à roulettes. Je laisse le passé au passé. Aujourd’hui c’est parfait : adéquation complète entre ce que je peux faire et ce que j’ai fait.
Rien ne manque.
« De corps apaisé, d’esprit apaisé, de coeur apaisé ».
Je me souviens d’un proverbe zen : « Ne soyez pas arrogant, même le cercle parfait de la lune ne dure qu’une nuit » et je commence à rire.
Si je me sens bien je recommence demain.
Ah avidité, je t’ai attrapée!!
DE L’ÉVEIL À L’ILLUSION, DE L’ILLUSION À L’ÉVEIL, SANS FIN…
Marpa avait un fils, un jeune homme plein de vie aimant les distractions de son âge. Marpa était un Maître bouddhiste, vivant au Tibet au 11e siècle. Après avoir longuement étudié en Inde, il retourna dans son pays, devint à la fois fermier, chef d’une importante communauté bouddhiste et chef de famille. Sa femme aussi était versée dans les enseignements du Bouddha et les pratiques de méditation. Il arriva que leur fils, au retour d’une fête du village voisin, tomba de cheval et resta agonisant sur le chemin. Lorsque Milarepa, le disciple de Marpa, mû par son intuition le trouva, le jeune homme était mourant. Milarepa le ramena à la ferme et appela ses parents. Marpa et sa femme devant le corps sans vie de leur fils se mirent à pleurer. Un des villageois lui dit alors : « Maître, je ne comprends pas; lorsque notre fils est mort vous nous avez tant aidé à surmonter notre douleur en nous expliquant les enseignements du Bouddha. L’impermanence de toute vie, la non existence du moi, l’illusion de toutes choses. Or maintenant, vous pleurez et vous vous lamentez devant le corps de votre fils. ». Marpa répondit : « Oui, il est vrai que tout n’est qu’illusion mais la mort d’un enfant est la plus grande de toutes les illusions. C’est un cauchemar dans le rêve. ». Et il resta auprès du cadavre.
Le lendemain matin, il réunit tous les siens et tout le village pour la cérémonie funéraire et il prononça ces mots :
« Mes émotions semblent parfois gravées dans la pierre – mais même la pierre n’est autre que lumière brillante.
Les apparences viennent du vide et retournent au vide, comprendre cela c’est entrer dans la paix du coeur. »
Mon nom de nonne complet est : ZUIMYÔ-JÔSHIN. J’ai expliqué Jôshin, le nom usuel, celui par lequel on m’appelle tous les jours. ZUIMYÔ, nom de funérailles, utilisé après ma mort : ZUY : bonheur spirituel, bonne fortune. MYÔ : indicible, merveilleux.
C’est cette merveille des enseignements du Bouddha que j’aimerais révéler ici – et aussitôt se mêle la peur; peur de ma maladresse : écrire à la première personne, c’est le paradoxe du moi qui prétend expliquer comment il a dépassé le moi ! Pourtant il me semble bien que c’est de ce moi qu’il faut partir parce que sinon on risque d’essayer de le cacher : illusion !
Peur aussi de l’arrogance : « Moi j’ai fait… » Moi-je, moi-je ? Est-ce que j’ai suffisamment dit : « Je n’aurais pas su faire cela, je n’aurais pas su passer par la maladie et la peur de la mort et y découvrir la paix et la joie. Je n’aurais pas pu explorer des paysages tellement plus beaux que ceux vus avec les yeux. Je n’aurais compris « Un cœur qui bat plus grand que l’univers, et Kanzéon est en son centre » sans toute l’aide que j’ai reçue.
Bonne fortune de venir au monde, d’abord, et sous cette forme humaine, dans ce seul monde qui donne accès à la libération de la Roue du Samsara, sous la seule forme qui permette d’accomplir notre nature profonde, notre nature d’Éveil.
Grâce à mes parents, et à tous les ancêtres à travers toutes les générations, à tous ceux qui leur ont permis de grandir et de vivre : merci. Bonheur merveilleux de naître en un lieu et en un temps où les enseignements du Bouddha sont accessibles, grâce aux efforts de milliers de Maîtres et de millions de pratiquants qui de génération en génération les ont retransmis depuis 2 500 ans, merci. A tous les Maîtres, moines et nonnes, à toutes les personnes rencontrées en France, en Amérique, au Japon, ceux qui m’ont permis d’entrer dans la Voie et de vivre ces enseignements, de connaître la joie indicible du Dharma, merci. A toutes les occasions d’apprendre et de pratiquer qui m’ont été offertes par tous ceux que j’ai rencontrés, pour tout ce que j’ai reçu de tous les êtres, souvent sans même les reconnaître, merci.
Où est-ce que ça s’arrête ?
Ça ne s’arrête pas, c’est sans limites.
C’est merci à travers les âges, à travers le monde,
à travers toutes les formes de vie,
et tous les univers – et ça ne s’arrête pas.
Merci.
”Du coin de l’oeil
je le regarde
du coin de l’oeil
il me sourit
Bouddha
sur la fenêtre”
Jôshin
HISTOIRES
● Les quatre rencontres du Bouddha ●
● La Roue du Samsara et les six mondes ●
● Le Filet d’Indra ●
”Si vous êtes moine ou poète, … univers”
● Texte complet sur le bodhisattva Kannon ●
”Comme une personne endormie…”
LES QUATRE RENCONTRES DU BOUDDHA
Quand naquit Sidharta, le futur Bouddha, un devin annonça à son père que son fils portait les marques d’un destin exceptionnel et qu’il deviendrait soit un roi victorieux et invincible, soit un guide spirituel dont la renommée emplirait ciel et terre.
Le père de Sidharta désirait avant tout un héritier pour le petit ”royaume” qu’il dirigeait. Aussi fut-il soucieux de ne pas voir se réaliser la deuxième possibilité. Il décida d’élever le jeune prince dans le luxe et la beauté, afin de l’attacher au monde et de ne lui donner aucune raison de rechercher une autre vie.
Chaque fois que le jeune prince se rendait en ville, les rues étaient vidées de tout ce qui pouvait évoquer la souffrance humaine. Aussi Sidharta avait-il déjà 29 ans lorsque se produisit la première rencontre.
Accompagné d’un serviteur, il sortit du palais par la porte Orientale, et il rencontra un vieillard – ayant perdu ses cheveux et ses dents, les yeux troubles, les membres faibles – marchant appuyé sur un bâton – « Qu’a-t-il?» demande-t-il à son serviteur, « Mais rien, c’est un vieillard qui n’a plus longtemps à vivre; c’est le sort commun qui nous attend tous ». Troublé, le prince retourna au palais – c’est la première rencontre.
Le lendemain passant par la porte du Sud, il vit un homme décharné, au souffle court, au teint jaunâtre, allongé sur le sol sans pouvoir bouger. « Qu’a-t-il ? » demanda-t-il à son serviteur. « C’est un malade, une personne dont le corps est épuisé et qui n’a plus longtemps à vivre; c’est le sort commun, vous et moi n’y échapperons pas. ». Encore plus troublé, le prince fit demi-tour. C’est la deuxième rencontre.
Le jour suivant, passant par la porte Occidentale, c’est devant un cortège funèbre qu’il s’arrêta. Un cadavre gonflé par la putréfaction et derrière des parents en pleurs. « Qu’a-t-il ? » « C’est un mort, son corps est abandonné; il ne profitera plus de la vie, il ne reverra ceux qu’il aime; c’est le sort commun, nous mourrons tous tôt ou tard. ». C’est la troisième rencontre.
Enfin la fois suivante, il vit passer un homme au crâne rasé, à la robe safran – marchant avec un bol d’aumônes, dont ”le maintien reflétait un esprit tranquille; il marchait avec grâce, sans peur et sans fierté”. « Qui est-ce ? ». « C’est un renonçant, un moine errant qui a tout quitté pour se tourner vers la vie sainte. ». Alors Sidharta comprit que c’est ainsi, en suivant cette voie de renoncement, qu’il pourrait s’aider lui-même et aider tous les êtres à surmonter la souffrance liée à la destinée humaine. C’est la quatrième rencontre.
Ce jour-là en son cœur il prit la décision de consacrer toute sa vie et toute son énergie à trouver ce chemin qui mène au-delà de la vie et de la mort.
Ce but sera atteint six années plus tard, au pied de l’arbre de la Sagesse. Il deviendra le Bouddha – l’Éveillé5, le Bienheureux – celui qui possède la Sagesse suprême, qui a ”mis un terme à l’immémoriale souffrance de la naissance, de la vieillesse et de la mort”.
C’est ce chemin, cette voie de l’Éveil qu’il enseigne pendant presque cinquante ans, parcourant les routes de l’Inde du Nord accompagné de ses disciples. Il meurt – ou, disent les bouddhistes, il entre dans le Nirvana de la complète extinction, le Parinirvana – après avoir réaffirmé aux moines qui l’entourent : « Tous les phénomènes composés sont soumis à la loi de l’impermanence. Comment ce qui est créé ne serait-il pas périssable ? Consacrez tous vos efforts à atteindre la perfection de la compréhension. »
LES SIX MONDES
la Roue du Samsara – de l’existence – représente les six formes de vies par lesquelles nous passons – les textes disent dans lesquelles nous errons – jusqu’à ce que nous aussi nous devenions des êtres éveillés.
Nous pouvons comprendre cette ronde de vie-en-vie à plusieurs niveaux : au sens premier de re-naissance, tantôt sous une forme tantôt sous une autre. On peut aussi voir comment nos états d’esprits nous entraînent, d’un instant à l’autre nous mourons et nous renaissons dans un de ces mondes.
Cette roue est, de par sa forme même, sans commencement et sans fin; il est d’usage de suivre un ordre décroissant pour la décrire, du plus au moins de souffrance.
– D’abord l’enfer, la souffrance absolue : un bloc de douleur physique et morale.
– Puis le monde des ”gakis”, ces démons affamés, avec un si grand corps, surmonté d’une petite tête et d’un cou étroit. Le lieu de l’avidité absolue, de la souffrance du ”jamais assez”; souffrance de l’impossibilité de satisfaire tous nos désirs à jamais.
– Le monde des animaux : manger, dormir, avoir chaud – satisfaction des sens. Une vie confortable centrée sur nos besoins physiques : cela paraît si attirant parfois! Se contenter d’aller comme le chien le nez collé au sol, sans lever la tête : lâcher la responsabilité de notre vie, ce qui fait la grandeur de notre humanité.
– Le monde des êtres humains : un monde où la souffrance est encore présente, mais le plus précieux car il est le seul dans lequel nous avons tous les moyens nécessaires pour sortir de cette souffrance. C’est la seule ”porte de sortie” du Samsara, le seul monde où nous pouvons réaliser notre nature-de-Bouddha. C’est pourquoi tous les textes nous invitent à prendre soin de notre vie. « Puisque vous avez reçu ce précieux corps humain, ne le gaspillez pas en vain; la vie est brève, on ne sait jamais ni où ni quand elle prendra fin; nous entrerons dans la mort suivi seulement de notre karma (de nos actes) bon ou mauvais. ».
– Le monde des dieux jaloux : c’est le monde du combat pour la toute puissance; moi, moi, moi je veux être le(la) meilleur(e). J’ai besoin de toute la place… Combat incessant où chaque ”autre” est vu comme un adversaire, un ennemi – impossible de s’arrêter, j’ai trop peur de perdre ce que je crois avoir acquis; puisque je ne connais que l’attaque, je suis sûr(e) que les autres vont m’attaquer si je baisse ma garde un moment. Un monde d’angoisse et d’épuisement !
– Enfin, le monde des ”dieux” – monde de félicité et de bonheur – un seul problème : il est soumis lui aussi à la loi de l’impermanence, et nous devrons le quitter pour retomber dans l’un des cinq autres.
Et sans cesse nous parcourons cette Roue : au cours d’une seule journée nous pouvons passer du paradis à l’enfer, suivant nos réactions à ce que nous rencontrons !
Nos états de contentement ne durent pas – quelque chose se produit, après une heure ou vingt ans, qui nous ramène aux mondes de la souffrance, mais l’enfer lui aussi est transitoire – même si la grande souffrance de cet état est que nous ne pouvons plus imaginer qu’il aura une fin.
Mais attention : nous ne sommes pas envoyés ça et là par un dieu, un destin, les étoiles – que sais-je. C’est nous-mêmes qui par nos actes, notre karma, créons cette ronde perpétuelle, et ces six mondes n’existent en fait que dans notre esprit. Parfois des actes terribles nous envoient en enfer. On peut imaginer l’enfer du remords, de la culpabilité – parfois des actes de compassion font naître un ”paradis” pour un moment plus ou moins long de bonheur qui ne dépend pas des conditions extérieures – mais dans tous les cas – tous ces états sont soumis à la loi de l’impermanence et nous continuons, entre souffrance et bonheur, à tourner dans cette roue, n’en sortant que lorsque nous passons ”au-delà”, au-delà de ces mirages, en nous éveillant à la pure vacuité de notre nature, en revenant à la source de l’Un qu’est la Réalité Ultime.
LE RECUEIL DE L’ÉQUANIMITÉ6
Texte n°54 : La Grande Compassion
Prologue :
De tous côtés clair comme le cristal, ouvert dans toutes les directions, irradiant la lumière, faisant trembler, exerçant ses pouvoirs spirituels de façon subtile à tous moments – dites-moi, comment cela se manifeste-t-il ?
Texte principal :
Yün-Yen demanda à Tao-Wu : « Que fait le bodhisattva de la Grande Compassion avec tant de mains et de tant d’yeux ? »
Tao-Wu dit : « Comme une personne endormie arrange son oreiller au plus profond de la nuit. »
Yün-Yen répondit : « – Je comprends.
– Comment le comprends-tu
– Sur tout son corps il y a des mains et des yeux.
– C’est bien dit mais tu n’as pas tout saisi.
– Et vous, frère aîné, que dites-vous ?
– Des mains et des yeux à travers tout son corps
Poème :
Vacuité qui pénètre tout,
Claire comme le cristal
de tous côtés.
Sans forme, sans ego, le printemps pénètre la terre.
Sans obstacle la lune traverse le ciel.
Des
yeux de purs joyaux, des bras ornements de la vertu :
Sur tout son
corps – comment le comparer à cela
qui est à travers son corps
?
Les mains et les yeux révèlent le travail du tout :
La
grande fonction s’exprime par tous les moyens
– Qu’y aurait-il
d’interdit ?
LE FILET D’INDRA7
L’école Kegon du Bouddhisme voit l’univers comme un immense réseau dans lequel tous les êtres et toutes les choses sont reliés – chaque être et chaque chose à la fois nécessaire et complètement éveillé – Hua-Yen fondateur de cette école, proposa l’image d’un filet ou d’une toile d’araignée où à chaque intersection brille un joyau aux facettes parfaitement taillées : chaque diamant est existant et unique, mais lorsque nous le regardons, son existence ne se perçoit que par les reflets qu’il donne des diamants qui l’entourent. Chaque joyau reflète la toile entière.
(Tiré de Avatamsaka Sutra : le Sutra de l’Ornementation Fleurie)
Le Maître vietnamien Thich Nhat Hanh, installé en France au Village des Pruniers présente cette même idée par une autre approche, que je trouve particulièrement inspirante : « Si vous êtes poète, ou moine Zen, dit-il, dans cette feuille de papier, vous pouvez voir tout l’univers. »
1Maître Dôgen : moine bouddhiste japonais du 13e siècle. Fondateur de l’école du Sôtô Zen.
2Voir le détail de ces six mondes p.46.
3J’ai
adapté librement à partir de ma méconnaissance totale de la
biologie,
la thèse captivante du Professeur Israël. Toutes les
erreurs trouvées ici sont miennes.
4« Sac de peau » expression utilisée par le moine Hakuin pour se désigner lui-même.
5Celui
qui s’est éveillé des illusions et de l’ignorance, qui a réalisé
la vacuité originelle. Comprenant la nature illusoire du moi, il a
transcendé les obstacles de la souffrance
et de la mort.
6D’après ”Two arrows meeting in Mid-Air ». J. Daïdo Loori.
7INDRA
: dans l’hindouisme il est ”le roi du ciel, le détenteur de la
foudre”.
On le retrouve dans les textes bouddhiques; le Bouddha
n’ayant jamais voulu bouleverser les traditions des cultes locaux,
de nombreux ”dieux” furent désignés ”protecteurs
de la loi
bouddhique”.
J’ai traversé cette période de maladie et de menace de mort comme toute autre personne (sauf sans doute quelques Sages et quelques Maîtres, déjà passés « au-delà ») avec difficulté, avec peurs. Grâce à l’enseignement du Bouddha, grâce aux années de pratique dans les monastères auprès de Maîtres patients et aux années de recherche et de tentatives pour mettre ces enseignements dans ma propre vie, quelques portes se sont entrouvertes.
Ce que je croyais avoir compris, je l’ai redécouvert : ce que je n’avais qu’entendu je l’ai un peu approché.
C’est cette vérité des enseignements du Dharma que j’aimerais retransmettre.
On raconte en Chine l’histoire d’un lettré bien décidé à connaître le fin mot des enseignements du Bouddha. Il visite beaucoup de Maîtres, mais il n’est jamais satisfait des réponses; on lui parle d’un vieux Sage qui vit là-bas, loin au-delà des montagnes. Parce que son aspiration à la connaissance est profonde, il part; il traverse des rivières en crue, franchit des précipices, repousse les attaques des brigands. Quand enfin, après bien des épreuves, il arrive à la grotte du Sage, il lui demande : « Maître, quels sont les enseignements primordiaux donnés par le Bouddha ? » Le Maître répond : « Ne pas faire le mal, faire le bien, aider tous les êtres. » Alors le lettré, dépité après tant de précipices, de rivières et de brigands s’exclame : « Mais Maître, même un enfant de cinq ans sait cela. » « Oui, répond le Maître, mais même un vieillard de cent ans n’arrive pas à le faire! ».
Il y a une idée assez répandue qui suggère que les moines et les nonnes bouddhistes sont des personnes d’une certaine réalisation spirituelle, différentes du commun des… mortels – mais je crois que ce n’est pas vrai. On ne devient pas moine/nonne parce qu’on en sait plus, mais parce qu’on veut en apprendre plus, et même consacrer sa vie à apprendre, à entrer dans l’étude et la pratique des enseignements du Bouddha. Peut-être deviendra-t-on plus sage, peut-être pas. Aucune garantie.
Entrer dans la vie monastique, c’est s’engager sur un chemin de simplicité et de dépouillement. Tout ce qui semblait nécessaire à notre identité, à notre être, nous allons l’abandonner; plus de vêtements personnels : nous sommes tous habillés pareils. Plus de cheveux : les disciples du Bouddha ont toujours le crâne rasé, homme ou femme. L’image de notre corps se transforme. Puis on change de nom, on quitte le nom qui nous reliait à notre enfance, à notre passé pour un nouveau nom dans une nouvelle vie : mort et re-naissance. Chaque journée est rythmée par l’horaire, pas de place pour ses propres habitudes; pas de refuge : plus de chambre personnelle, souvent pas même un lit mais un matelas dans la salle de méditation; plus de préférences : à chaque repas nous mangeons ce que nous recevons dans notre bol. Comme une approche de la mort, apprendre tout ce qu’il nous faudra abandonner – et expérimenter la joie de la légèreté, du non-avoir.
Et puis la méditation matin et soir : un silence où le « je » disparaît – parfois : « Abandonner complètement son corps et son esprit. »
Maître Dôgen1
Alors après des années de cette vie, on peut penser qu’on a un peu appris, un peu fréquenté la mort – je le pensais en tout cas, mais j’avais sous-estimé la différence entre mort symbolique et mort dans le corps. Cancer – au sein même de la cellule : la mort.
Bien sûr on connaît la chaleur du poêle mais le jour où l’on met brusquement la main dessus, on la réalise dans son propre corps. « Je sais bien (que je suis mortel/le) mais quand même… ». J’ai vu que l’identification au corps était toujours bien là. Le choc de l’impermanence ! Comprendre quelque chose avec sa tête, vivre quelque chose dans son corps, quelle différence !
Maître Dôgen dit que la connaissance vraie doit pénétrer « Pas la peau, pas la chair, pas les os, mais jusqu’à la moëlle des os ».
L’impermanence, c’est l’enseignement du Bouddha :
« Notre existence est passagère comme les images d’automne; regarder la naissance et la mort des êtres, c’est regarder les mouvements d’une danse. Une vie entière est un éclair d’orage dans le ciel; elle se précipite comme un torrent qui dévale la montagne. » (Dhammapada). Et lorsqu’il vit certains de ses disciples se désespérer à l’approche de sa mort, il leur rappela : « Comment ce qui est créé ne serait-il pas périssable ? Comment ce qui est né ne serait-il pas impermanent ? ».
Mais cette impermanence ne signifie pas : « Alors quelle importan-ce, puisque ma vie va finir de toute façon, pourquoi y faire attention, qu’importe si je détruis mon corps et mon esprit ? » Parce qu’ils ne nous appartiennent pas; parce que nous les avons reçus, comme un don, et que nous devons donc en prendre soin. Même si nous sommes seuls, malades, abandonnés, nous ne savons à quel moment, à qui, cette vie donnée sera un jour utile.
Il est vrai que l’histoire du monde n’est que création et destruction. Un paléontologue a écrit : « Il est clair qu’une planète Terre en mouvement n’offre jamais de conditions stables et durables pour aucune des formes vivantes qui l’habitent. ». Mais ce monde aussi nous l’avons reçu en héritage et nous devons le transmettre. Même si nous savons que tout va disparaître, que dans plusieurs milliards d’années, le soleil lui-même va s’éteindre. Nous vivons maintenant notre vie et chacune de ces vies, non seulement celle de chaque être humain mais de chaque être vivant, jusqu’au plus infime, est précieuse – précieuse et mortelle.
Oui, mais moi ? Moi !? Là, maintenant, peut-être à peine dans quelques mois ? Découverte : je fais partie de l’ensemble; je ne suis pas spectatrice, dans mon fauteuil devant l’écran de télé qui retransmet les souffrances et la mort. Je ne suis pas metteur en scène de ma vie, comme j’en avais l’illusion parfois, essayant d’organiser mon petit, petit monde autour de moi.
Je suis en plein dedans. Il faudra tout laisser. Tout ? Tout. Cela semblait si improbable, si lointain – j’ai l’impression d’avoir jusqu’à présent marché dans le brouillard, et d’un coup, je m’écrase contre un mur, là où j’imaginais une route spacieuse, s’étirant à l’infini.
Maître Dôgen a forgé un nouveau concept : ”Naissance-et-mort”, en un seul mot. Pas naissance à un bout, et mort à l’autre bout là-bas très loin, un jour… non, ”naissance-et-mort”, le tout là, au même instant. Impossible de prendre naissance sans simultanément, sans aucun écart, avoir ”mort”. Nous le savons, des milliards d’êtres humains ont affronté cette réalité avant nous. Chacun a dû, devra refaire la même découverte, le même chemin vers l’acceptation. Comment ne pas être touché par l’histoire de Kisagotami, cette femme portant son enfant mort dans les bras, refusant qu’on le lui prenne pour l’incinérer, se jetant aux pieds du Bouddha, le suppliant de faire un miracle. « Oui, dit le Bouddha, je peux sauver ton enfant; mais pour cela il faudra que tu m’apportes trois graines de moutarde provenant d’une maison dans laquelle il n’y a jamais eu de mort. ». Pleine d’espoir, elle va, frappe à toutes les portes, mais – ici un vieillard, là une jeune femme – dans tous les foyers la même réponse. Et le lendemain matin, triste et silencieuse, elle dépose son enfant sur le bûcher funéraire.
Je suis assise dans un petit square. Je regarde les arbres en fleurs, c’est beau. Je n’ai rien contre l’impermanence des cerisiers en fleurs. Je l’ai fétée au Japon, avec petits gâteaux, thé vert et saké sous les dits cerisiers – ni contre celle de la rose-à-peine-éclose, apprise à l’école – mais la mienne, moi-mon corps, là ça cale un peu.
DEUXIÈME RENCONTRE
Alors je fais un peu de mélo devant le printemps : facile. Fonda-mentalement notre esprit aime les histoires dont nous sommes le centre, éternel acteur/actrice. Développer des scénarios (et si je… et si cela…), imaginer des dialogues, rejouer des situations déjà vécues ou imaginaires : clichés et lieux communs à fleur de peau, émotions caressées dans le sens du poil (après ce qu’il m’a fait…). Et là je tenais un bon sujet – avec lamentations et incrédulité et rebondissements (métastases ou pas métastases ?).
Ça commence comme ça : « Que c’est beau le printemps ! Et c’est peut-être le dernier printemps que je vais voir ! ». Du présent au futur, du regard à l’appropriation : la fleur me plaît, je la cueille pour pouvoir en profiter plus longtemps. Je fais du mélo parce que, même si c’est vrai, cette idée (dernier printemps ?) est d’abord là pour faire naître de l’émotion. C’est appuyer sur la dent qui fait mal, repasser sur les lieux d’une rupture, ressasser une phrase blessante : construire activement une émotion pour se sentir exister. Presser un bouton et ça marche : même les émotions pénibles, angoisse, tristesse, colère, sont bienvenues dans nos scénarios. Juste s’asseoir et profiter de la vue des arbres en fleurs – l’art de vivre en étant pleinement dans l’instant présent. Ce n’est pas donné, cela s’apprend, c’est l’enseignement de la méditation.
Une partie de cet apprentissage vise à discipliner notre esprit : d’abord voir comment sans cesse on attrape un sujet, un thème : nos pensées vagabondent, ramassent ceci, le lâchent, récupèrent autre chose : dans les textes on compare l’esprit à un singe, c’est amusant à regarder un singe, il voit quelque chose qui brille, il s’en saisit, le goûte, le rejette; fonce sur une ombre, dévie en chemin; il tire à lui et il repousse. Il est mû par toutes ses impulsions, ne reste pas en place… On s’en lasse vite, ça devient fatiguant à voir – et pourtant c’est ce que nous faisons la plupart du temps. Mais nous n’avons que rarement le loisir d’examiner notre esprit pour voir comment il fonctionne. Même la nuit ça ne s’arrête pas, les rêves ou les pensées, toujours en mouvement, que nous ne contrôlons pas.
Discipliner l’esprit – c’est un mot bien rébarbatif que celui de disci-pline ! Cela signifie prendre conscience de l’enchaînement de nos pensées, comment l’une (si belles fleurs : printemps) tire l’autre par association (printemps : prochain printemps) et pouvoir l’interrompre quand on s’aperçoit qu’on va se perdre, ou ressasser, ou faire mal à soi ou à un autre. Puis on peut aller un pas plus avant : qu’y a-t-il à l’origine même de ces pensées. Souvent un simple désir de distraction – plutôt de ”divertissement” au sens pascalien, souvent aussi, nous allons retrouver un des trois poisons entraînant la souffrance décrits par le Bouddha : l’avidité, la colère et l’ignorance.
Là c’est simple, il n’y a pas à chercher loin : j’ai déjà vécu quarante sept printemps – et j’en veux encore ! Pas assez, jamais assez. Encore trente ? Quarante ? Mais non après cela je sais bien que j’en voudrais encore, c’est le piège du désir que d’être insatiable ! Cinq mille, cent mille, deux cent mille ? Ah, deux cent mille, oui, alors là ça se calme. Avec deux cent mille printemps garantis devant moi, je pourrais me tranquilliser; car ce que j’ai eu, je le veux encore, je le veux ”pour toujours”. Ah ! Toujours ! Ne rien perdre, ne rien lâcher, et même avoir encore plus; comme ces esprits du bouddhisme, les gakis. Les gakis sont les habitants d’un des six mondes de la Roue du Samsara, la roue des existences2. Petite tête, petite bouche, cou étroit – et corps énorme… Jamais rassasiés, toujours affamés. Pas seulement de nourriture : il y a les gakis de la réussite sociale et les gakis de l’amour insatiable, les gakis du sexe et ceux du savoir, les gakis matériels et les gakis spirituels – pas difficile de voir un gaki : il suffit souvent de se regarder dans une glace !
Et pourtant l’avidité n’est pas une chose mauvaise en soi. Pas un élément de nous-même que nous devrions éradiquer, par la force ou par la volonté. C’est ce qui nous a permis de vivre : un bébé qui ne serait pas avide de vivre, de respirer, de manger ne survivrait pas. L’avidité c’est aussi la curiosité, le goût d’aller plus loin, de continuer à avancer. L’avidité, ce désir de ne jamais finir, de ne jamais mourir est peut-être inscrit dans nos cellules, dans nos gènes.
On sait que le cancer est une réaction qui privilégie la survie cellu-laire : à travers les tissus, une cellule entame un périple dans le temps et l’espace et une fois différenciée (cellule des bronches, de l’intestin, etc.), elle remplit ses fonctions grâce à l’action sur ses gènes d’un grand nombre de substances; lorsque ces fonctions cessent, la cellule normale ”se suicide” en sécrétant une enzyme qui la détruit; un mystérieux signal prévient une cellule souche, qui se divise pour que la perte soit comblée. Mais la cellule devenue cancéreuse fait exactement le contraire, elle ”refuse” de se suicider, elle repart dans l’organisme, elle se fixe où elle ne devrait pas, elle ne ”veut” qu’une chose : survivre. Tout ce qui l’entoure devient menace, elle élabore des stratégies très sophistiquées pour se défendre, aussi bien contre l’organisme (dont elle fait partie) que contre les traitements visant à protéger l’ensemble de ce même organisme. Avidité ! A ne pas vouloir mourir, elle va entraîner la mort du corps et donc la sienne.
On
retrouve à notre échelle humaine cette stratégie du refus : refus
de se rendre aux circonstances, refus du changement rendu
incontournable par une perte, ou un deuil. Nous aussi, nous élaborons
des stratégies d’aveuglement ou de défense. Tout ce qui ne va pas
dans notre sens devient ennemi, nous nous renfermons, nous essayons
de bloquer le cours des choses – autant essayer d’arrêter un
torrent avec la main ! Et par ce refus, il y a une part de
nous-même qui s’ankylose et qui meurt. Nous cherchons à échapper au changement, et c’est la vie qui nous échappe.
Mais
là non plus, rien n’est complètement blanc, ni complètement
noir
: d’après la théorie personnelle du Professeur Israël, nous
au-rions hérité cette nécessité de la survie de nos ancêtres
bactériens : histoire merveilleuse de ces bactéries qui, à travers
toutes les catastrophes qui ont détruit des milliers d’espèces,
parviennent à survivre depuis trois milliards d’années, à devenir
de plus en plus résistantes à tous les traitements que nous leur
opposons, à communiquer entre espèces différentes pour se repasser
cette résistance… La puissance de la vie envers et contre tout,
qui a permis le jaillissement de la diversité qui nous entoure –
puissance de la vie qui est protégée chez ces bactéries par ”un
arsenal d’armes multi-cibles et de défenses tous azimuts qui se met
en place à la moindre agression et se déploie de façon similaire
contre toutes sortes de menaces potentielles”.
Sans cette résistance, sans ce refus de mourir (difficile d’en parler sans anthropomorphisme) la vie aurait peut-être très tôt disparu de la planète Terre. Nos cellules, en dignes descendantes de ces bactéries, ont intégré leurs gènes; les bons, ceux qui réparent les brins d’ADN comme les autres, ceux qui se hérissent devant l’idée de disparaître : parfois à contre-temps chez l’homme, une cellule va déployer tout son arsenal pour survivre : cancer3.
Ce qui a été source de tout ce qui vit dans l’univers devient pour l’individu menace de mort. Cette faculté géniale qui a assuré l’expansion de la vie se transforme en danger mortel : la frontière entre vie et mort est plus ambigüe qu’il n’y paraissait. Puis-je alors mettre mon existence en balance avec la survie de tout le vivant ?
Oui, je peux !! Je comprends l’ensemble, mais dans la moëlle des os… Les moments d’acceptation alternent avec les moments d’émotions.
Choc devant la mort, choc devant ma propre avidité; je reconnais au milieu de ma confusion comment des phrases lues et répétées se sont petit à petit inscrites dans ma tête et dans mon corps, comme ces paroles du Bouddha :
« A ceux qui se trouvent au milieu de la mer
Quand la terreur naît de la masse des eaux,
J’annonce l’île,
A ceux qui sont atteint
Par la vieillesse et la mort,
J’annonce l’île… »
TROISIÈME RENCONTRE
Aujourd’hui rendez-vous chez une spécialiste pour les derniers examens. Elle ne me dit rien, mais ses yeux se détournent quand elle me conseille de prendre très rapidement rendez-vous avec le chirurgien.
Continuer à respirer, sortir, s’arrêter dans la rue devant la porte cochère : des personnes vont et viennent, discutent, font des achats, regardent les vitrines, rient – et moi moi moi, complètement seule, comme déjà séparée, coupée des autres, projetée dans un autre monde.
Moment de souffrance absolue, je reste paralysée sur le trottoir.
Et
là une petite étincelle : « Je ne suis pas la seule »;
pas la seule femme qui a reçu ce diagnostic aujourd’hui : d’autres
en ce moment sont aussi seules dans la rue, ou désespérées devant
leurs enfants, ou essayant d’en parler avec leur famille. Je suis
seulement l’une d’elles. Et puis d’autres personnes, hommes et
femmes, d’autres cancers, d’autres maladies, d’autres souffrances. Je
suis seulement l’une d’entre elles. Des malades, des mourants dans
les hôpitaux, ce matin, hier, depuis toujours – et moi parmi eux,
moi avec eux, il n’y a
plus de séparation. Si je tourne le regard vers moi, si ce moi emplit toute ma conscience sans qu’il y ait place pour autre chose, alors c’est intenable, c’est l’enfer. On parle de l’enfer dans le bouddhisme, un autre des six mondes du Samsara, et j’ai toujours imaginé cet enfer comme un espace resserré et étouffant : des murs qui se touchent presque; pas la place de bouger, de respirer – où que l’on se tourne, des murs, pas d’air, pas d’espace. Et nos peurs, nos haines, nos colères enfermées avec nous. Dès que je pense ”moi-moi” je tombe dans cet enfer; mais lorsque je réalise, comme cette femme portant cet enfant mort, que les autres et moi, nous vivons fondamentalement les mêmes choses, les mêmes joies, les mêmes peurs : je suis l’une d’entre eux, ils pourraient être moi. Je vois comment je suis reliée à ces milliers, ces millions de personnes et je suis là – pas au centre mais un maillon ni plus ni moins essentiel, ni plus ni moins transitoire que les autres – un fil de la trame qui unit tous les êtres.
Alors c’est tout l’espace qui s’ouvre, je peux respirer, nous sommes ensemble – tous reliés au-delà de nos différences superficielles.
Maintenir vivantes ces compréhensions : dès qu’il n’y a plus que des mots comme des feuilles mortes, détachées de l’arbre, toutes recroquevillées et sèches, la souffrance revient, et le refus et la peur.
Souffrance dès que je me renferme sur ce moi, puisqu’il est si transitoire, puisqu’il va peut-être disparaître : je veux m’appuyer et je tombe dans le vide. Mais dès qu’il y a ouverture, regard tourné vers l’extérieur, c’est l’expérience de la tranquillité et de la paix.
Pour m’aider, je prends appui sur le bodhisattva Kanzéon. Bodhisattva : si on regarde du dehors, le bodhisattva semble un intermédiaire entre nous, personnes ordinaires, et Bouddha. Ce qui le distingue du Bouddha, c’est qu’il n’a pas encore réalisé le grand Éveil, il n’est pas entré dans le Nirvana; ce qui le distingue de nous, c’est la résolution sans faille prise en son cœur de se consacrer uniquement au bonheur de toutes les créatures, afin de faire passer tous les autres avant lui sur l’autre rive de l’Éveil.
Chaque bodhisattva représente une facette de la sagesse suprême, et il porte en lui le germe de l’Éveil : l’aspiration à devenir Bouddha, non pour soi-même mais pour aider tous les êtres sensibles. En ce sens le bodhisattva est une part de nous-mêmes puisque chaque être humain peut devenir Bouddha – plus exactement peut réaliser, faire apparaître le Bouddha déjà présent en lui. Le bodhisattva est amour – et cet amour est déjà là, au cœur de chacun d’entre nous. Le bodhisattva est donc à la fois à l’extérieur (ainsi il nous inspire) et à l’intérieur (pas de différence entre Bouddha, le bodhisattva et nous) de nous-mêmes.
Il y a des bodhisattvas inconnus tout autour de nous et les bodhisattvas célèbres du panthéon bouddhique : le bodhisattva de la Sagesse, de la Pratique et bien d’autres, mais le plus connu, et sans doute le plus aimé, est le bodhisattva de la Compassion.
Son nom sanskrit Avalokiteshvara signifie « Le Seigneur qui regarde d’en haut (avec miséricorde) ». En Chine, il est souvent représenté sous sa forme féminine, et s’appelle Guanyin. Au Japon, c’est Kanzéon (ou Kannon) : « Celui qui écoute les cris du monde » ou « Celui qui répond aux souffrances du monde ».
Il existe beaucoup de représentations différentes de cet être de compassion puisque Kanzéon à la faculté de se présenter sous l’aspect qui convient le mieux à chacun; c’est parfois une silhouette méditative vêtue de blanc au cœur de la montagne, parfois Kanzéon à tête de cheval, qui se consacre plus spécialement aux êtres nés dans le monde animal. Et puis, celle que je garde devant les yeux, Kanzéon ”qui fait face à toutes les directions”, Kanzéon aux onze visages, et aux mille bras. Dans chaque paume de main, un œil : voir la détresse, agir pour la secourir. Kanzéon, ce n’est pas une statue, mais une part de chacun : s’arrêter pour secourir quelqu’un, sourire, aller vers un enfant qui pleure – C’est Kanzéon.
Sans réfléchir, sans calculer, simplement lorsque je ressens la souffrance de l’autre et que j’y réponds. C’est un geste d’unité : soulager l’autre c’est me sentir bien. Nous le faisons sans le savoir et celui qui reçoit notre aide n’en est pas embarrassé. La moindre ombre de ”moi” rend souvent notre aide difficile à accepter pour l’autre et nous ne comprenons pas pourquoi : « Moi qui… voulais l’aider… ». Mais c’est qu’à ce moment-là, il n’y a plus Kanzéon face à Kanzéon, je suis bien « Le Seigneur qui regarde d’en haut », mais la miséricorde, la compassion – au sens d’être un avec – a disparu. Kanzéon c’est les autres et moi, ensemble.
Et cette histoire qui me revient sans cesse à l’esprit, une de ses histoires zen dont le sens semble si difficile à saisir, jusqu’à ce qu’elle pénètre ”jusqu’à la moelle des os” : le moine Lungan demande à Maître Dôgô : « Comment est-ce que le bodhisattva Kanzéon utilise toutes ses mains et tous ses yeux ? ». Dôgô répond : « Comme une personne en dormant arrange son oreiller au milieu de la nuit ».
Là où il n’y a plus ”moi” et ”toi” – une transparence totale – personne pour donner, personne pour recevoir – le don pur.
Je sais que je peux choisir : ignorer tous les êtres et rester seule, ou reconnaître que moi aussi, comme chacun, j’ai dix mille yeux et dix mille bras, et me tourner vers les autres : il n’y a qu’une réalité, dont nous sommes tous une partie. Parce que la fin de la souffrance de tous les êtres commence aussi par moi : comprendre ma propre souffrance c’est partager celle de tous les autres, alléger ma propre souffrance c’est alléger la souffrance du monde. Moi – ”sac de peau”4 est souffrance, moi-Kanzéon est paix. Il n’y a pas de choix, mais effort, oui, pour ne pas se laisser aller à l’inertie du moi, à la soi-disant évidence ”moi ce n’est pas les autres”, au repli, à la coupure : l’enfer.
Se rappeler – oublier. L’esprit qui essaie de s’accrocher, l’esprit qui lâche prise. Je n’ai rien fait de spécial, je me sens une personne bien ordinaire – confrontée à quelque chose de très grand, de très difficile. Une question essentielle, pas un jeu de l’esprit mais une chose très concrète, qui suis-je ? Je dois donner une solution tout de suite, une réponse urgente; pas pour me faire plaisir, ou réaliser un grand éveil, une grande illumination mais parce que c’est exactement au sens premier du terme une question de vie et de mort : qui suis-je ? Et ”moi”, ”moi” je n’ai pas de réponse – mais seulement du refus, l’envie de ne pas être là, pas à ce moment-là, pas exactement où je suis.
« Je sais bien… » qu’il n’y a pas d’autre endroit, pas d’autre possible que ce qui y est – mais le savoir de la tête, le savoir des mots n’est d’aucune aide. Je l’ai lu et relu : « Tout n’est qu’illusion, le moi la plus grande des illusions », mais illusion pour illusion, j’en choisirais bien une autre… des siècles plus tôt, déjà, cri du cœur du poète : « Rosée que cette vie, rosée, et pourtant… ».
Mais le Dharma, l’enseignement du Bouddha me montre la seule solution, la seule réponse : oui – une acceptation totale, mais une acceptation de tous les instants, de toutes les circonstances, de tout le vécu : oui à la maladie, oui à la peur de la maladie, oui à la mort et oui à la peur de la mort. Oui, sans jugement, sans « Je devrais », « Je ne devrais pas »; oui à ce que je suis, ce que je vis, ce qui est aujourd’hui, ce qui sera demain.
Oui, ce n’est pas un oui du bout des lèvres, parce qu’on est écrasé, par résignation; c’est un élan de tout notre être, corps et esprit confondus. Bien sûr, cela ne veut pas dire ne pas prendre soin de soi, ne pas se soigner quand c’est nécessaire – bien au-delà, c’est un oui à ce qui est.
Faire
un pas en avant, s’ouvrir, ne pas bloquer, ne pas refermer, ne pas
refuser de bouger alors même que toutes les choses changent
autour et au dedans de moi : le oui qui englobe tout, voilà l’ensei-gnement que j’ai reçu et l’occasion, la nécessité de le mettre en pratique.
Enseignement qui me touche au plus près puisque c’est la signification de mon nom de nonne : ”JÔ-SHIN” : JÔ pure, SHIN foi : Foi Pure. Pendant des années ma question a porté sur le premier mot : Foi. Foi ? En qui ? En quoi ? Quelle foi dans le bouddhisme ? Le Bouddha a souvent répété : « Ne croyez pas une chose parce que je la dis, ne croyez pas une chose parce qu’elle est écrite mais regardez si ces enseignements sont bons, qu’ils ne font pas de mal, que les personnes sages les acceptent car leur pratique entraîne bonheur et compassion. ».
Nous
sommes encouragés à expérimenter les enseignements, vérifier que
cela est le bon chemin qui nous mène vers moins de souffrance et
plus de joie. Et puis quand nous voyons que cela est juste, nous
pouvons avoir confiance – peut-être une première étape vers
”foi”. On entend dire : « J’ai confiance dans la vie »
– ou seulement « Je ne crains rien, j’ai confiance. » –
Là il faut gratter un peu, qu’est-ce que cette confiance recouvre ?
Souvent sans en avoir conscience, nous pensons « J’ai confiance
parce qu’au fond je sais
bien que tout va s’arranger comme je veux. » – Une forme de pensée magique : puisque j’ai confiance, je mérite bien d’en être récompensée. Et on a construit une protection imaginaire, un donnant-donnant subtil : comme une petite digue en bambou et si une grande vague arrive et nous balaye nous nous écrions « Ce n’est pas juste ! Moi qui avais confiance ! Alors là j’ai compris, la confiance ça ne marche pas; maintenant je ne croirai plus en rien, ni en personne. ».
Exact, la confiance dans ce sens-là ne marche pas. La confiance ne se marchande pas : il y a seulement j’ai confiance. Point. J’ai confiance : je peux m’ouvrir assez pour accepter tout ce qui va arriver. La ”confiance-point” ne nous décevra jamais puisque nous ne construisons rien. Il n’y a pas d’abri, pas de murs, rien à perdre. Il ne s’agit pas d’échafauder une théorie pour se consoler : aucune théorie ne tient devant les grandes vagues de la perte, du deuil, de la mort. Il s’agit de faire entrer, jusqu’à la moelle des os « Que ta volonté soit faite ». Foi s’écrit en japonais en réunissant deux signes : le signe de la personne et le signe de la parole. La parole d’une personne, la parole du Bouddha – non pas y croire parce que ”c’est comme ça”, mais la laisser imprégner le corps et l’esprit, découvrir dans le mouvement même de la vie, la vérité contenue dans cette parole. Il ne restera alors que confiance. Point. Foi. Point.
Et puis ”Pur” était resté un peu de côté, pendant les tâtonnements qui me menaient vers ”Foi”. Il a réapparu, au fil d’une lecture « Corps et cœur-esprit complètement purs ». C’était une parole libératrice car je me suis rendue compte que j’entendais pur en opposition à impur, et que je devais trouver ce qu’était ”pur”, seul, sans opposition. Si le corps et le cœur-esprit sont purs, il ne reste plus de place pour impur. C’est une qualité intrinsèque qui ne peut être changée, ni ôtée, ni modifiée : si je comprends cette parole au-delà de la dualité, je peux voir les autres et moi et toutes les choses dans la transparence de cette pureté. Lorsque la foi pure est là, elle imprègne toutes choses, elle englobe tout sans distinction, comme le soleil qui brille sur toutes choses sans choisir : un rayon de lumière passe par la fenêtre et même la poussière se change en or. Maître Dôgen : « Quand la foi pure apparaît, elle change les autres comme elle nous change nous-même. ».
Cette foi pure, c’est dire oui, bienvenue. Bienvenue à tout, pas seulement à ce que je désire, à ce que j’attends. Être assez spacieux pour accueillir tout ce qui se présente. Oui. Quel travail !
Le travail de la méditation d’abord. Difficile à comprendre comment le fait de rester assis, sur un coussin, ou bien sur une chaise, sans bouger peut nous aider à résoudre les problèmes posés par notre vie quotidienne.
La méditation dans le zen, ”zazen” ne se fixe sur aucun objet, sur aucune phrase; ce n’est pas une technique, cela ne consiste pas à vider notre esprit, à respirer de façon spéciale, ni à s’identifier à un son, une lumière ou autre chose; c’est ”être là” – pleinement, consciemment, attentivement. Être là instant après instant, respiration après respiration. « Mais ça tout le monde le fait ? ». Asseyez-vous cinq minutes et regardez où vous arrivez : hier, demain, là-bas, au bureau, en vacances.. Si peu ”ici et maintenant”. Constructions mentales : peurs ou espoirs dans l’avenir, joies ou blessures du passé, vivement demain, vivement la semaine prochaine… Des pensées qui tournent, répétitives – des émotions, encore. D’abord apprendre à être là, à dompter cet esprit rétif comme un cheval sauvage. La méditation n’est pas une fuite. La fuite, tant d’occasions dans notre vie ! Livres, TV, films, discussions, rêveries… Ce n’est pas un abri, un refuge, comme un jardin secret où nul ne pourrait entrer. Ce n’est pas prendre de la distance, bâtir des murs pour ne plus être embêté par ce monde extérieur qui refuse si obstinément de se plier à mes désirs. Au contraire, c’est ouverture, espace, transparence; dans le calme d’abord, puis dans le silence. Comme un verre d’eau puisé dans la rivière : d’abord flottent toutes sortes de particules, l’eau est trouble, mais si on le pose, si on ne le bouge plus, petit à petit les impuretés se déposent au fond et l’eau devient transparente. La méditation, le zazen, dans mon école s’appelle réflexion sereine, au sens où un grand miroir vide réfléchit la lumière, ou illumination silencieuse.
La méditation est la racine du oui.
Petit à petit elle imprègne la vie : ce n’est pas réservé à un lieu, un moment, un contexte spécial. Ce n’est pas opposé au monde de l’activité, du travail, des rencontres. C’est une qualité propre dans notre vie : être là, dans toutes les situations, être en harmonie. Étant nous-mêmes en unité, nous entrons en unité avec tout ce qui nous entoure. Parce que cela est difficile au sein de la vie quotidienne, nous prenons le temps de la méditation assise, plusieurs heures par jour pendant les retraites dans les monastères – et depuis des années cette méditation m’accompagne comme le corps est accompagné de son ombre : parfois très présente, parfois indiscernable. Mais au milieu de cette confusion, je continue plus que jamais à prendre le temps de m’asseoir, de revenir à moi-même, de retourner au vrai silence.
Comment dire que la méditation sera là tout au long de cette maladie, tout au long de ces pages, à chaque pas, non pas pour m’y cacher, pour essayer de me soustraire à ce présent douloureux, mais au contraire pour le vivre, totalement, ici et maintenant.
Un Maître zen contemporain Maître Uchiyama l’a bien résumé : « Même si le diable me fait sauter dans sa poêle, je continue à faire zazen. ». Moi aussi, je saute et je brûle avec les autres; je poursuis zazen avec les autres.
La méditation, zazen, c’est s’ouvrir à chaque respiration comme on ouvre une porte pour accueillir ses hôtes : ouvrir la porte, sourire, et accueillir tout ce qui se tient sur le seuil : bienvenue.
Ici, pendant ces jours de bouleversement, j’entre dans la compréhension de cette ”foi pure” qui m’accompagne depuis dix ans. Le oui se fait un peu de place : la seule réponse, toutes les autres ne débouchent que sur la souffrance. Oui, parce que cela est – le reste n’est que fantasme, fantaisies, tentatives vouées à l’échec de construire ”mon” monde, mon paradis et moi toute puissante.
Quand je fais ce pas vers, ou dans, ce oui, tout se détend, mon esprit comme mon corps – les craintes s’évanouissent, tout est harmonie.
Puis, comme des portes qui se referment, je ne suis plus sûre : ai-je vraiment vécu cela ou l’ai-je rêvé ? Où est passé tout cet espace, où a disparu toute cette beauté ? Retravailler, avec patience, accepter ses limites, jusqu’à revenir au oui qui englobera également ces moments de ”nuit obscure”. Retour à la méditation.
QUATRIÈME RENCONTRE
Nous chantons tous les matins : « La Voie du Bouddha est sans fin, je fais vœu de la suivre ».
Sans fin : il n’y a pas d’acquis à mettre de côté; la Voie du Bouddha, la vie, n’est pas un objet fini, bien clos. Il n’y a que le chemin, que je trace moi-même à chaque pas, à chaque respiration, à chaque instant. Je ne vais arriver nulle part, pas de port, pas de havre : dans la Roue des existences le paradis lui-même est transitoire. J’ai envie de croire qu’un moment difficile va se terminer, et qu’ensuite tout ira bien…
Mais le chemin est neuf à chaque instant, il faut continuer, et quoi qu’on trouve en avançant, continuer encore. Je ne peux m’installer nulle part. L’expérience acquise, la compréhension ne sont que des bases partielles à partir desquelles je devrai apprendre encore. Comme lorsqu’on avance sur un sentier de montagne, le paysage se fait plus vaste; l’œil ne peut le saisir en entier, la main ne peut pas l’attraper. Dès que je pense « Ça y est, j’ai compris » ou « J’ai accepté », on retombe dans le petit moi, on se raconte des histoires, on croit qu’on possède quelque chose – mais tout s’échappe; on se retourne : l’enfer, case départ.
Le jour de l’opération est fixé. Je dois arriver de bonne heure à l’hôpital, un peu loin en banlieue. Sans trop penser, gardant un œil sur la discipline de l’esprit, je prends le RER, puis un bus. Au fil du trajet, sans m’en apercevoir, la discipline s’efface devant un nouveau mélo, quelque chose comme « Tous ces gens autour, fatigués, de mauvaise humeur, et moi alors, moi moi moi qui vais me faire opérer d’un cancer, moi qui… moi que… ». J’arrive devant l’hôpital, un immense bâtiment de béton, quelques lumières, quelques silhouettes. Émotion : « Alors là, c’est vraiment un instant important dans ma vie… devant l’hôpital où on va… etc. Et en plus je suis toute seule, pas de compagnon, d’enfants ou d’amis auprès de moi, etc. Toute seule. ». Je suis l’héroïne du scénario, le centre du monde. Moi.
J’avais souvent répété pour moi-même ou pour d’autres, cette phrase de Maître Dôgen : « Est-ce que je regarde la montagne, ou est-ce la montagne qui me regarde ? ». Je la trouvais stimulante, poétique, drôle. Mais quand elle déboule à l’improviste dans ce flot de pensées j’ai l’impression de sauter de l’autre côté du décor et d’apercevoir la machinerie qui sous-tend la pièce.
Comme d’un geste preste on remet un vêtement à l’endroit, mettant en lumière la beauté et la richesse de l’étoffe qui semblait si terne, je peux voir soudain la vraie texture de cet instant : quelle merveille!
La fatigue, la tristesse s’effacent, et, né de l’immense gratitude qui m’emplit, apparaît le deuxième mot, l’autre face du oui : merci.
Je ne sais pas en fait à qui s’adresse ce merci : c’est un changement de perspective total, un bouleversement profond : je venais enfermée en moi-même et tout-à-coup ce merci jaillit et brise tous les murs. Ce merci est bien plus grand que moi et il englobe et dépasse l’hôpital, et toutes les personnes qui y travaillent, toutes celles qui sont en route pour y venir. Il dépasse la raison de ma présence – Il est cette ”présence” même car il s’adresse aussi à toutes les personnes croisées dans ma vie – et à toutes celles qui me sont inconnues. C’est un merci qui résume toute ma vie, qui la transforme en un don sans limites et me donne envie de me partager avec tous les êtres. C’est un merci qui dépasse ma vie, car il me traverse, il était là avant moi, il est la nature même de chaque personne et de chaque chose. Je ne fais que le mettre à jour, l’actualiser avec mon corps et mon esprit. Il est communion, unité. Il me semble à cet instant que c’est la seule approche possible de ”la-vie-la-mort”, notre composante la plus solide et la plus intime. C’est l’écho de la naissance du moindre brin d’herbe et de l’apparition de Kanzéon, porté par l’air, il se réverbère à l’infini, pas un atome de poussière n’en est exclu. Merci.
Ce matin je réalise pour la première fois ce que le Bouddha appelle ”ignorance” : la fausse croyance en un moi séparé, et son antidote : oui, merci. Et la gratitude, celle qui ne dépend pas des évènements et qui s’adresse à tous sans exception, sans réticence fait naître en moi une joie profonde. Joie sans objet qui recouvre tout; je ne suis plus qu’un réceptacle vide (et peut-être est-ce encore trop) traversé par cette joie. C’est le début et la fin, l’espace sans limites, la danse sans danseur. Oui. Merci.
De ce moment tout devient plus simple, plus léger – même si je ne le vis toujours que de façon transitoire. Sans savoir comment, je me retrouve dans la colère « Pourquoi est-ce qu’elle ne frappa pas à la porte de la chambre avant d’entrer ? » ou dans la crainte « Quand même ces médecins qui ne me disent rien… ».
Parfois séparation et souffrance, des pensées qui bourdonnent, des émotions qui jaillissent. Si je reste attentive, je peux sentir la crispation qui les accompagne dans les épaules, le ventre, les jambes. Respiration, retour au calme : le corps se relâche, le visage se détend. Impermanence de la compréhension même.
Et depuis, je continue. Je continue à passer de l’ombre à la lumière – et dans la lumière je m’aperçois que l’ombre n’existe pas. Je continue à oublier et à m’agiter ”moi, moi, moi” et à revenir, encore et encore, à merci. La joie pourtant, comme le grand ciel bleu, parfois visible, parfois non, mais toujours là.
Respiration : « J’ai jeté cette petite chose qu’on appelle le moi et depuis je suis empli par l’univers entier »; chant de joie du moine Mûso, et je danse avec lui. De temps en temps, je le perds un peu de vue ce moi, triste ou joyeux, craintif ou brave. Puis je me surprends empêtrée dans la reconstitution laborieuse de mon petit monde, qui s’écroule aussi vite que je le construis.
Comme le dit si drôlement Pema Chödron : « Alors c’est donc ça le chemin qui a du cœur, on dirait plutôt le chemin du vol plané dans la boue. ». Et on apprend à tomber – et à se relever. On apprend surtout à accepter de tomber, le nez par terre ! Finies notre belle dignité, nos certitudes. Bienvenue au vol plané dans la boue ! Petit inconfort ou grand enfer, ça va. Bienvenue à tout ce qui se présente, c’est aussi je crois la grande patience face à notre lenteur, à nos entêtements. Merci, je dois le dire aussi à moi-même.
L’humilité de la chute, c’est aussi m’apercevoir combien je tenais à un certain nombre de motifs – peut-être pas de fierté – mais disons de satisfaction. Un objet agréable, le motif de satisfaction : « moi-je ». On peut le tourner entre ses mains pour l’admirer sous toutes ses faces, le poser, le reprendre, jouer avec. « Moi, j’ai toujours… moi je n’ai jamais… ».
Je ne veux pas dire, loin de là, que nous devrions demeurer éternellement insatisfaits de nous-même : la tolérance envers moi-même va fonder ma tolérance envers les autres; si je me critique sans cesse, il y a de fortes chances pour que je critique sans cesse les autres aussi. Le premier travail du oui sera l’acceptation totale de ce que je suis – bons et moins bons côtés, parce que c’est là mon point de départ ! Je n’en ai pas d’autres que moi-même ! Je dois accepter de ne pas être parfaite – et j’accepterai mieux l’imperfection des autres.
Si je n’ai pas d’amour pour moi comment pourrais-je même me représenter l’amour pour les autres ? Si je ne reconnais pas : « moi-Kanzéon » – qui inclut ce petit moi imparfait – comment le reconnaîtrais-je chez les autres ? Cette insatisfaction fera obstacle et m’empêchera de vivre les 10 000 bras et 10 000 yeux qui m’unissent aux autres. La gratitude vraie ne différencie pas entre nous et les autres.
Mais
c’est une bonne idée de repérer tous ces petits ”moi-je »
qui nous permettent de nous tenir à l’écart de la foule des autres
– voire un peu au-dessus. J’en ai trouvé un certain nombre :
« Moi, je n’ai jamais manqué une méditation du matin depuis
que je vis dans les temples… » « Moi qui suis capable
de travailler plus que n’importe qui » – Écroulement d’un
grand pan de l’ego ! Non seulement je ne me suis plus levée le
matin, non seulement je n’ai plus travaillé, mais j’ai appris à
rester tranquille, à remercier avec reconnaissance les personnes qui
préparaient ma nourriture, lavaient mes affaires, faisaient le
ménage pour moi. Gratitude. Jamais facile. J’ai tout plein de Bonnes
Raisons pour être maussade, irritable : mal-ci, mal-là, pas dormir,
pas manger… « Ce n’est pas ça que je voulais, pas
maintenant; justement, je me reposais… » Je suis vaguement
jalouse de ces personnes capables d’aller et venir sans effort, de
marcher et de courir. « Moi qui étais si active, qui faisais
tant de sport, et d’arts martiaux… ». Ça paraît si tentant
de laisser ce ”je” envahir la journée, de s’apitoyer un peu sur
soi-même, de s’accrocher à l’image qu’on se fait du passé : je le
vois bien, je le fais parfois; on a envie de se rouler en boule sur
sa souffrance, et la souffrance devient tout notre univers, emplit
tout l’espace – temps figé, corps crispé : enfer. « Ce que
j’ai eu, pourquoi est-ce que je ne l’ai plus ? Ce que j’aimais,
pourquoi
est-ce que je dois l’abandonner ? ». Fausses questions, il n’y a pas de raisons mais le travail de l’impermanence : mon corps change, mon esprit change; les conditions, intérieures ou extérieures, changent : encore et toujours l’impermanence. Et la même réaction d’avidité : je veux tout – pour toujours !
Respirer, revenir à la transparence, se tourner vers Kanzéon : Kanzéon en moi quand je fais l’effort de lâcher la tentation de l’enfermement ; Kanzéon chez les autres quand je tourne mon regard vers eux. Alors, j’ai, nous avons tous 10 000 bras, 10 000 yeux… qu’y a-t-il que je ne puisse faire ?!
Tout se remet à l’endroit : merci pour tout ce qui est donné, merci pour tout ce qui reste – et un jour ou l’autre, je devrai apprendre à réduire ce ”tout” à ”presque rien”, et dire encore merci. Et merci enfin pour tout ce que j’ai eu dans cet ”avant” : ce merci va m’aider à clore le passé et me permettre de le laisser reposer.
Deux ans après, je vais bien, c’est en tout cas ce que disent les derniers examens. Je ne sais pas comment je réagirai, si dans six mois ou dans vingt ans, je rechute. Et surtout j’essaie de ne pas me faire attraper par des illusions, des constructions mentales flattant mon ego « La prochaine fois je serai plus ci… moins ça… ». Car cette réaction fabriquée à l’avance recouvrant ce que je ressens réellement
m’obligerait à mentir, à moi-même et aux autres. Je serais bloquée dans une image de moi, coupée de mes émotions, toute mon énergie consacrée à tenir ma propre statue à bout de bras ! Quelle souffrance, bien pire que n’importe quelle peur.
Alors que le oui, le merci continue à s’agrandir pour pouvoir tout englober, de la joie à la tristesse, de la vie à la mort.
Et le Dharma, l’enseignement du Bouddha m’apprend une chose essentielle : que je sois malade, que je meure, ce sont là les conséquences naturelles de ma naissance. Ce n’est pas un échec, pas un échec de la méditation, pas un échec de la médecine, ni de moi-même.
C’est refuser la réalité de notre nature humaine que de croire qu’on peut se mettre du côté du ”bon” (bonnes pensées, bon esprit, bonne nourriture, ”bon karma”) et que cela nous préservera du ”mauvais” – alors on ne mourra jamais ?
Il n’y a pas des gagnants en bonne santé et des perdants malades. On peut voir la mort, comme un passage, une transformation ou une fin – mais la mort n’est en aucun cas une défaite : tout le monde va mourir, et vous et moi aussi – ”vie-et-mort” en un seul mot : « Tout ce qui est composé est impermanent; tournez vos efforts vers la libération. », ce furent les dernières paroles du Bouddha.
En tant que pratiquants du Dharma, nous considérons que ce qui nous arrive, tout ce que nous rencontrons dans notre vie découle du karma, c’est-à-dire de l’enchaînement des causes et des effets. Un acte entraîne une conséquence, qui à son tour devient une cause, ainsi de suite. Ce qui survient dans cette vie peut être le résultat des actes de la vie précédente – ou de cette vie même – et les actes de cette vie porteront leurs fruits dans une vie future. Mais attention, il n’y a rien là de linéaire, lois du karma et lois naturelles s’entrecroisent : on ne peut jamais pointer du doigt un événement de notre vie, ou celle de quelqu’un d’autre, ou un problème, un accident, etc. et dire : « C’est parce que je/vous avez commis des fautes dans le passé ! ». Le Bouddha met en garde souvent contre cela, disant que nul ne peut démêler son propre karma – sûrement alors encore moins celui des autres. Mais lorsque nous nous voyons à travers les yeux de Kanzéon, le jugement disparaît – ne reste que l’égalité totale moi et les autres.
Le karma n’est pas rigide, ce n’est pas un destin (ni une excuse à nos insuffisances !) : à chaque instant nous pouvons changer; et il me semble aujourd’hui que la seule porte vers ce changement c’est ce oui, ce merci total. Ils font s’écrouler les murs de la souffrance mais n’empêcheront jamais la maladie et la mort inhérentes à notre forme d’être humain.
SAMADHI (une sorte de…)
C’est un autre square, un vrai square de carte postale : minuscule, entre deux immeubles avec des gamins qui jouent, des jeunes qui s’embras-sent et des personnes âgées assises le sac sur les genoux. Avant je ne l’avais jamais remarqué, je marchais à toute allure, avec un but, ou pour le plaisir. Pourtant il n’est qu’à un pâté de maisons de l’appartement.
Je suis sur un banc à regarder autour, pas de journal, pas de livre. Un groupe de lycéens traverse le square en chahutant, je sens mon corps qui se recroqueville; dehors est devenu un peu dangereux : peur des rollers, des skates, des distraits ou des pressés; peur d’être heurtée, de tomber. J’ai un bras toujours replié sur le côté gauche, et la main droite prête à chercher un appui. Comme dans un conte de fées où on s’endort jeune, et on se réveille centenaire, je fais l’expérience d’un autre corps, d’une autre ville.
Je
suis de plain-pied avec le quatrième âge, et je m’étonne parfois
qu’on ne m’aide pas à traverser la rue. Dix minutes passent, et je
commence à me sentir mal fichue, une vague envie de m’allonger sur
le banc, il est temps de rentrer. La grille du square est lourde à
tirer, d’ailleurs la porte de l’immeuble aussi est devenue très
pénible à ouvrir. Je marche comme nous le faisons dans la salle de
méditation, lentement, à petits pas, au rythme de la respiration.
Je suis consciente de chaque pas, de la texture des pavés sous mes
pieds,
de l’air que je respire. J’ai le temps de regarder chaque
vitrine, chaque entrée d’immeuble. Je sens le plaisir de bouger mon
corps,
les articulations un peu raides, et aussi quelques signaux d’alarme qui disent qu’il est temps de rentrer.
En
bas de l’escalier, je retrouve ma voisine de palier, madame B.
94
ans. Son aventure à elle, c’est descendre son petit sac plastique
jusqu’aux poubelles. Quand j’arrive, elle est en train de prendre son
élan pour les quatre étages à remonter.
Nous nous faisons des politesses : « Allez-y » « Mais non, je vais très lentement, vous d’abord », etc. – et nous y allons. Elle me double dans la montée du troisième étage. Enfin j’arrive, m’allonger, me reposer un peu.
Je sens la détente de mon corps, les plis des couvertures sous mon dos, l’air léger au-dessus de mon ventre. Je suis présente du bout des doigts de pied jusqu’au crâne. Parfaitement satisfaite corps et esprit. Dans une autre vie, je pouvais traverser Paris du nord au sud à pied ou en patins à roulettes. Je laisse le passé au passé. Aujourd’hui c’est parfait : adéquation complète entre ce que je peux faire et ce que j’ai fait.
Rien ne manque.
« De corps apaisé, d’esprit apaisé, de coeur apaisé ».
Je me souviens d’un proverbe zen : « Ne soyez pas arrogant, même le cercle parfait de la lune ne dure qu’une nuit » et je commence à rire.
Si je me sens bien je recommence demain.
Ah avidité, je t’ai attrappée!!
DE L’ÉVEIL À L’ILLUSION,
DE L’ILLUSION À L’ÉVEIL, SANS FIN…
Marpa avait un fils, un jeune homme plein de vie aimant les distractions de son âge. Marpa était un Maître bouddhiste, vivant au Tibet au 11e siècle. Après avoir longuement étudié en Inde, il retourna dans son pays, devint à la fois fermier, chef d’une importante communauté bouddhiste et chef de famille. Sa femme aussi était versée dans les enseignements du Bouddha et les pratiques de méditation. Il arriva que leur fils, au retour d’une fête du village voisin, tomba de cheval et resta agonisant sur le chemin. Lorsque Milarepa, le disciple de Marpa, mû par son intuition le trouva, le jeune homme était mourant. Milarepa le ramena à la ferme et appela ses parents. Marpa et sa femme devant le corps sans vie de leur fils se mirent à pleurer. Un des villageois lui dit alors : « Maître, je ne comprends pas; lorsque notre fils est mort vous nous avez tant aidé à surmonter notre douleur en nous expliquant les enseignements du Bouddha. L’impermanence de toute vie, la non existence du moi, l’illusion de toutes choses. Or maintenant, vous pleurez et vous vous lamentez devant le corps de votre fils. ». Marpa répondit : « Oui, il est vrai que tout n’est qu’illusion mais la mort d’un enfant est la plus grande de toutes les illusions. C’est un cauchemar dans le rêve. ». Et il resta auprès du cadavre.
Le lendemain matin, il réunit tous les siens et tout le village pour la cérémonie funéraire et il prononça ces mots :
« Mes
émotions semblent parfois gravées dans la pierre –
mais même
la pierre n’est autre que lumière brillante.
Les apparences
viennent du vide et retournent au vide,
comprendre cela c’est
entrer dans la paix du coeur. »
Mon nom de nonne complet est : ZUIMYÔ-JÔSHIN. J’ai expliqué Jôshin, le nom usuel, celui par lequel on m’appelle tous les jours. ZUIMYÔ, nom de funérailles, utilisé après ma mort : ZUY : bonheur spirituel, bonne fortune. MYÔ : indicible, merveilleux.
C’est cette merveille des enseignements du Bouddha que j’aimerais révéler ici – et aussitôt se mêle la peur; peur de ma maladresse : écrire à la première personne, c’est le paradoxe du moi qui prétend expliquer comment il a dépassé le moi ! Pourtant il me semble bien que c’est de ce moi qu’il faut partir parce que sinon on risque d’essayer de le cacher : illusion !
Peur aussi de l’arrogance : « Moi j’ai fait… » Moi-je, moi-je ? Est-ce que j’ai suffisamment dit : « Je n’aurais pas su faire cela, je n’aurais pas su passer par la maladie et la peur de la mort et y découvrir la paix et la joie. Je n’aurais pas pu explorer des paysages tellement plus beaux que ceux vus avec les yeux. Je n’aurais compris « Un cœur qui bat plus grand que l’univers, et Kanzéon est en son centre » sans toute l’aide que j’ai reçue.
Bonne fortune de venir au monde, d’abord, et sous cette forme humaine, dans ce seul monde qui donne accès à la libération de la Roue du Samsara, sous la seule forme qui permette d’accomplir notre nature profonde, notre nature d’Éveil.
Grâce à mes parents, et à tous les ancêtres à travers toutes les générations, à tous ceux qui leur ont permis de grandir et de vivre : merci. Bonheur merveilleux de naître en un lieu et en un temps où les enseignements du Bouddha sont accessibles, grâce aux efforts de milliers de Maîtres et de millions de pratiquants qui de génération en génération les ont retransmis depuis 2 500 ans, merci. A tous les Maîtres, moines et nonnes, à toutes les personnes rencontrées en France, en Amérique, au Japon, ceux qui m’ont permis d’entrer dans la Voie et de vivre ces enseignements, de connaître la joie indicible du Dharma, merci. A toutes les occasions d’apprendre et de pratiquer qui m’ont été offertes par tous ceux que j’ai rencontrés, pour tout ce que j’ai reçu de tous les êtres, souvent sans même les reconnaître, merci.
Où
est-ce que ça s’arrête ?
Ça ne s’arrête pas, c’est sans
limites.
C’est merci à travers les âges, à travers le monde,
à
travers toutes les formes de vie,
et tous les univers – et ça
ne s’arrête pas.
Merci.
”Du coin de l’oeil
je le regarde
du coin de l’oeil
il me sourit
Bouddha
sur la fenêtre”
Jôshin
HISTOIRES
● Les quatre rencontres du Bouddha ●
● La Roue du Samsara et les six mondes ●
● Le Filet d’Indra ●
”Si vous êtes moine ou poète, … univers”
● Texte complet sur le bodhisattva Kannon ●
”Comme une personne endormie…”
LES QUATRE RENCONTRES DU BOUDDHA
Quand naquit Sidharta, le futur Bouddha, un devin annonça à son père que son fils portait les marques d’un destin exceptionnel et qu’il deviendrait soit un roi victorieux et invincible, soit un guide spirituel dont la renommée emplirait ciel et terre.
Le père de Sidharta désirait avant tout un héritier pour le petit ”royaume” qu’il dirigeait. Aussi fut-il soucieux de ne pas voir se réaliser la deuxième possibilité. Il décida d’élever le jeune prince dans le luxe et la beauté, afin de l’attacher au monde et de ne lui donner aucune raison de rechercher une autre vie.
Chaque fois que le jeune prince se rendait en ville, les rues étaient vidées de tout ce qui pouvait évoquer la souffrance humaine. Aussi Sidharta avait-il déjà 29 ans lorsque se produisit la première rencontre.
Accompagné d’un serviteur, il sortit du palais par la porte Orientale, et il rencontra un vieillard – ayant perdu ses cheveux et ses dents, les yeux troubles, les membres faibles – marchant appuyé sur un bâton – « Qu’a-t-il ? » demande-t-il à son serviteur, « Mais rien, c’est un vieillard qui n’a plus longtemps à vivre; c’est le sort commun qui nous attend tous ». Troublé, le prince retourna au palais – c’est la première rencontre.
Le lendemain passant par la porte du Sud, il vit un homme décharné, au souffle court, au teint jaunâtre, allongé sur le sol sans pouvoir bouger. « Qu’a-t-il ? » demanda-t-il à son serviteur. « C’est un malade, une personne dont le corps est épuisé et qui n’a plus longtemps à vivre; c’est le sort commun, vous et moi n’y échapperons pas. ». Encore plus troublé, le prince fit demi-tour. C’est la deuxième rencontre.
Le jour suivant, passant par la porte Occidentale, c’est devant un cortège funèbre qu’il s’arrêta. Un cadavre gonflé par la putréfaction et derrière des parents en pleurs. « Qu’a-t-il ? » « C’est un mort, son corps est abandonné; il ne profitera plus de la vie, il ne reverra ceux qu’il aime; c’est le sort commun, nous mourrons tous tôt ou tard. ». C’est la troisième rencontre.
Enfin la fois suivante, il vit passer un homme au crâne rasé, à la robe safran – marchant avec un bol d’aumônes, dont ”le maintien reflétait un esprit tranquille; il marchait avec grâce, sans peur et sans fierté”. « Qui est-ce ? ». « C’est un renonçant, un moine errant qui a tout quitté pour se tourner vers la vie sainte. ». Alors Sidharta comprit que c’est ainsi, en suivant cette voie de renoncement, qu’il pourrait s’aider lui-même et aider tous les êtres à surmonter la souffrance liée à la destinée humaine. C’est la quatrième rencontre.
Ce jour-là en son cœur il prit la décision de consacrer toute sa vie et toute son énergie à trouver ce chemin qui mène au-delà de la vie et de la mort.
Ce but sera atteint six années plus tard, au pied de l’arbre de la Sagesse. Il deviendra le Bouddha – l’Éveillé5, le Bienheureux – celui qui possède la Sagesse suprême, qui a ”mis un terme à l’immémoriale souffrance de la naissance, de la vieillesse et de la mort”.
C’est ce chemin, cette voie de l’Éveil qu’il enseigne pendant presque cinquante ans, parcourant les routes de l’Inde du Nord accompagné de ses disciples. Il meurt – ou, disent les bouddhistes, il entre dans le Nirvana de la complète extinction, le Parinirvana – après avoir réaffirmé aux moines qui l’entourent : « Tous les phénomènes composés sont soumis à la loi de l’impermanence. Comment ce qui est créé ne serait-il pas périssable ? Consacrez tous vos efforts à atteindre la perfection de la compréhension. »
LES SIX MONDES
la Roue du Samsara – de l’existence – représente les six formes de vies par lesquelles nous passons – les textes disent dans lesquelles nous errons – jusqu’à ce que nous aussi nous devenions des êtres éveillés.
Nous pouvons comprendre cette ronde de vie-en-vie à plusieurs niveaux : au sens premier de re-naissance, tantôt sous une forme tantôt sous une autre. On peut aussi voir comment nos états d’esprits nous entraînent, d’un instant à l’autre nous mourons et nous renaissons dans un de ces mondes.
Cette roue est, de par sa forme même, sans commencement et sans fin; il est d’usage de suivre un ordre décroissant pour la décrire, du plus au moins de souffrance.
– D’abord l’enfer, la souffrance absolue : un bloc de douleur physique et morale.
– Puis le monde des ”gakis”, ces démons affamés, avec un si grand corps, surmonté d’une petite tête et d’un cou étroit. Le lieu de l’avidité absolue, de la souffrance du ”jamais assez”; souffrance de l’impossibilité de satisfaire tous nos désirs à jamais.
– Le monde des animaux : manger, dormir, avoir chaud – satisfaction des sens. Une vie confortable centrée sur nos besoins physiques : cela paraît si attirant parfois! Se contenter d’aller comme le chien le nez collé au sol, sans lever la tête : lâcher la responsabilité de notre vie, ce qui fait la grandeur de notre humanité.
– Le monde des êtres humains : un monde où la souffrance est encore présente, mais le plus précieux car il est le seul dans lequel nous avons tous les moyens nécessaires pour sortir de cette souffrance. C’est la seule ”porte de sortie” du Samsara, le seul monde où nous pouvons réaliser notre nature-de-Bouddha. C’est pourquoi tous les textes nous invitent à prendre soin de notre vie. « Puisque vous avez reçu ce précieux corps humain, ne le gaspillez pas en vain; la vie est brève, on ne sait jamais ni où ni quand elle prendra fin; nous entrerons dans la mort suivi seulement de notre karma (de nos actes) bon ou mauvais. ».
– Le monde des dieux jaloux : c’est le monde du combat pour la toute puissance; moi, moi, moi je veux être le(la) meilleur(e). J’ai besoin de toute la place… Combat incessant où chaque ”autre” est vu comme un adversaire, un ennemi – impossible de s’arrêter, j’ai trop peur de perdre ce que je crois avoir acquis; puisque je ne connais que l’attaque, je suis sûr(e) que les autres vont m’attaquer si je baisse ma garde un moment. Un monde d’angoisse et d’épuisement !
– Enfin, le monde des ”dieux” – monde de félicité et de bonheur – un seul problème : il est soumis lui aussi à la loi de l’impermanence, et nous devrons le quitter pour retomber dans l’un des cinq autres.
Et sans cesse nous parcourons cette Roue : au cours d’une seule journée nous pouvons passer du paradis à l’enfer, suivant nos réactions à ce que nous rencontrons !
Nos états de contentement ne durent pas – quelque chose se produit, après une heure ou vingt ans, qui nous ramène aux mondes de la souffrance, mais l’enfer lui aussi est transitoire – même si la grande souffrance de cet état est que nous ne pouvons plus imaginer qu’il aura une fin.
Mais attention : nous ne sommes pas envoyés ça et là par un dieu, un destin, les étoiles – que sais-je. C’est nous-mêmes qui par nos actes, notre karma, créons cette ronde perpétuelle, et ces six mondes n’existent en fait que dans notre esprit. Parfois des actes terribles nous envoient en enfer. On peut imaginer l’enfer du remords, de la culpabilité – parfois des actes de compassion font naître un ”paradis” pour un moment plus ou moins long de bonheur qui ne dépend pas des conditions extérieures – mais dans tous les cas – tous ces états sont soumis à la loi de l’impermanence et nous continuons, entre souffrance et bonheur, à tourner dans cette roue, n’en sortant que lorsque nous passons ”au-delà”, au-delà de ces mirages, en nous éveillant à la pure vacuité de notre nature, en revenant à la source de l’Un qu’est la Réalité Ultime.
LE RECUEIL DE L’ÉQUANIMITÉ6
Texte n°54 : La Grande Compassion
Prologue :
De tous côtés clair comme le cristal, ouvert dans toutes les directions, irradiant la lumière, faisant trembler, exerçant ses pouvoirs spirituels de façon subtile à tous moments – dites-moi, comment cela se manifeste-t-il ?
Texte principal :
Yün-Yen demanda à Tao-Wu : « Que fait le bodhisattva de la Grande Compassion avec tant de mains et de tant d’yeux ? »
Tao-Wu dit : « Comme une personne endormie arrange son oreiller au plus profond de la nuit. »
Yün-Yen répondit :
« – Je comprends.
– Comment le comprends-tu ?
– Sur tout son corps il y a des mains et des yeux.
– C’est bien dit mais tu n’as pas tout saisi.
– Et vous, frère aîné, que dites-vous ?
– Des mains et des yeux à travers tout son corps. »
Poème :
Vacuité
qui pénètre tout,
Claire comme le cristal
de tous côtés.
Sans
forme, sans ego, le printemps pénètre la terre.
Sans obstacle la
lune traverse le ciel.
Des
yeux de purs joyaux, des bras ornements de la vertu :
Sur tout son
corps – comment le comparer à cela
qui est à travers son corps
?
Les mains et les yeux révèlent le travail du tout :
La
grande fonction s’exprime par tous les moyens
– Qu’y aurait-il
d’interdit ?
LE FILET D’INDRA7
L’école Kegon du Bouddhisme voit l’univers comme un immense réseau dans lequel tous les êtres et toutes les choses sont reliés – chaque être et chaque chose à la fois nécessaire et complètement éveillé – Hua-Yen fondateur de cette école, proposa l’image d’un filet ou d’une toile d’araignée où à chaque intersection brille un joyau aux facettes parfaitement taillées : chaque diamant est existant et unique, mais lorsque nous le regardons, son existence ne se perçoit que par les reflets qu’il donne des diamants qui l’entourent. Chaque joyau reflète la toile entière.
(Tiré de Avatamsaka Sutra : le Sutra de l’Ornementation Fleurie).
Le Maître vietnamien Thich Nhat Hanh, installé en France au Village des Pruniers présente cette même idée par une autre approche, que je trouve particulièrement inspirante : « Si vous êtes poète, ou moine Zen, dit-il, dans cette feuille de papier, vous pouvez voir tout l’univers. »
1Maître Dôgen : moine bouddhiste japonais du 13e siècle. Fondateur de l’école du Sôtô Zen.
2Voir le détail de ces six mondes p.46.
3J’ai
adapté librement à partir de ma méconnaissance totale de la
biologie,
la thèse captivante du Professeur Israël. Toutes les
erreurs trouvées ici sont miennes.
4« Sac de peau » expression utilisée par le moine Hakuin pour se désigner lui-même.
5Celui
qui s’est éveillé des illusions et de l’ignorance, qui a réalisé
la vacuité originelle. Comprenant la nature illusoire du moi, il a
transcendé les obstacles de la souffrance
et de la mort.
6D’après ”Two arrows meeting in Mid-Air ». J. Daïdo Loori.
7INDRA
: dans l’hindouisme il est ”le roi du ciel, le détenteur de la
foudre”.
On le retrouve dans les textes bouddhiques; le Bouddha
n’ayant jamais voulu bouleverser les traditions des cultes locaux,
de nombreux ”dieux” furent désignés ”protecteurs
de la loi
bouddhique”.
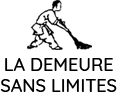

1 Comment
Nathalie Delay
Merci beaucoup pour ce partage, à la fois authentique, humble et profond, c’est un enseignement par le vrai, par le vécu et c’est ce qui touche au cœur. Merci de nous offrir votre humanité dans toute sa grandeur et sa vulnérabilité.